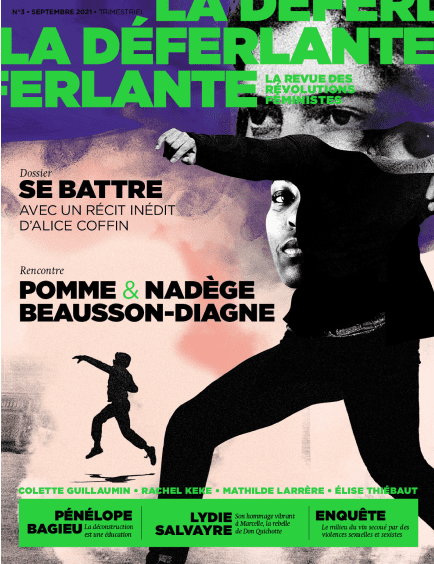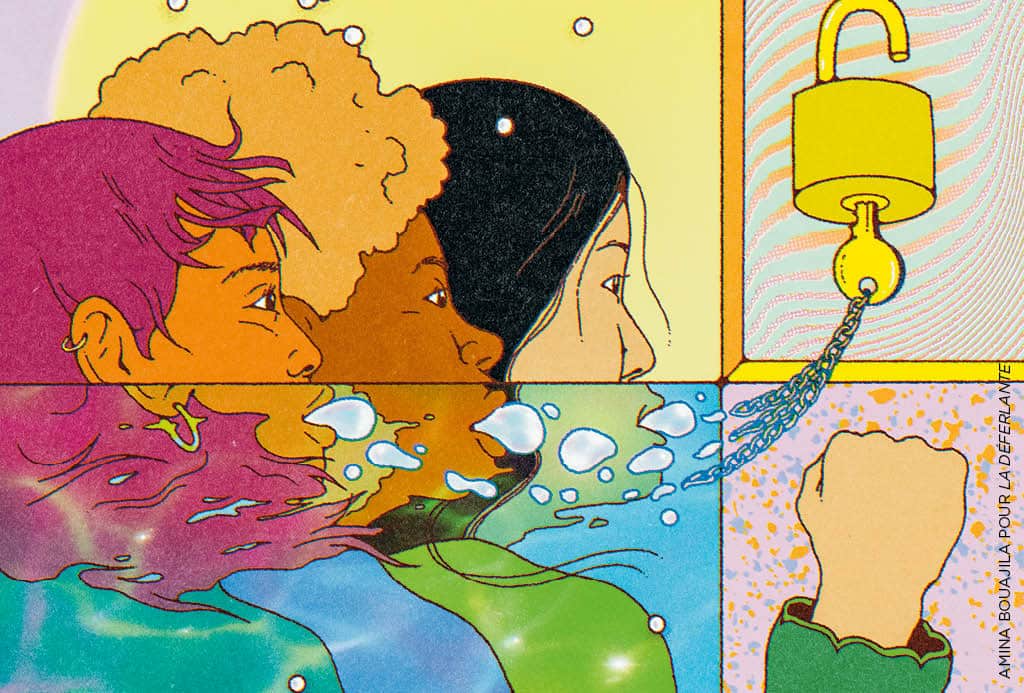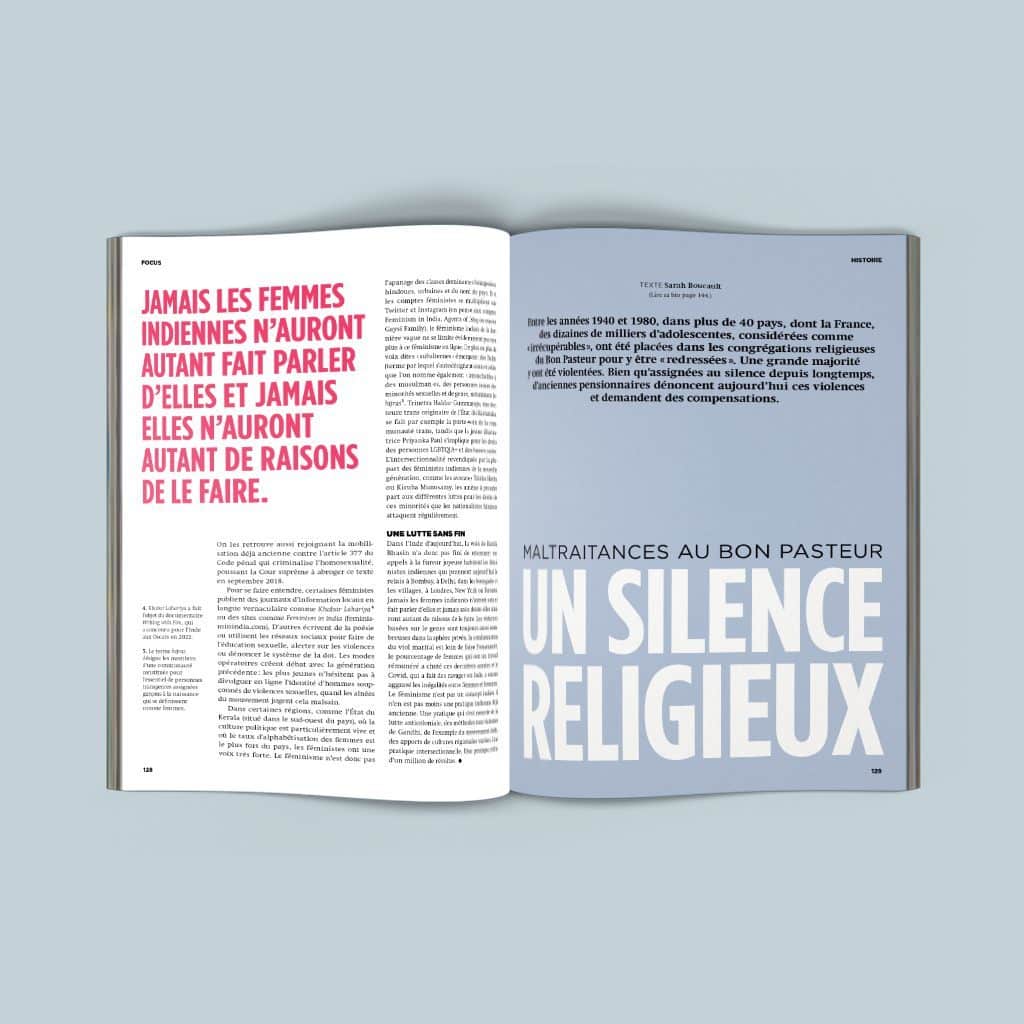L’imposant bloc de béton contraste avec le décor des montagnes de Malaga qui lui font face. C’est le palais de justice. Au troisième étage de ce bâtiment de 70 000 m², sur une porte en verre, un écriteau en lettres blanches sur fond vert annonce : « Tribunal dédié à la violence à l’égard des femmes ».
Sur les 3 500 tribunaux que compte l’Espagne, 106, dont trois à Malaga, traitent exclusivement les affaires pénales et civiles concernant les violences commises sur des femmes dans le couple. Les juges – un ou une par tribunal – y instruisent les dossiers et sont habilité·es à juger les délits dits « légers » (insultes, harcèlement, menaces) en présence de procureur·es spécialisé·es. Ces magistrat·es reçoivent une formation spécifique en ligne d’une durée de seize heures. Trois salles au sous-sol accueillent exclusivement les procès pénaux de violences de genre avec trois autres juges – un équivalent des tribunaux correctionnels français mais spécifiquement dédiés aux violences de genre. Les délits les plus graves sont jugés dans des cours régionales (audiencia provincial), et les crimes au tribunal del jurado, compétent pour les meurtres et assassinats (les assises françaises).
Cette semaine-là, en février dernier, María Concepción de Montoya, cheveux auburn frisés tombant sur un blouson en cuir, est de garde. En plus de gérer les dossiers en cours, elle auditionne les hommes violents ayant été arrêtés et reçoit les femmes qui viennent de déposer plainte. La justice a 72 heures pour traiter une plainte « urgente » pour violences de genre. « Protéger les femmes victimes doit être notre priorité », énonce avec énergie la juge de 50 ans, à la tête de cette juridiction depuis quatorze ans
Ces tribunaux ont été créés en 2004, date de la promulgation de la « loi de mesures de protection intégrale contre les violences de genre » exercée par un (ex-)partenaire. « La violence de genre n’est pas un problème qui concerne la sphère privée. Elle se manifeste au contraire comme le symbole le plus brutal de l’inégalité. Il s’agit d’une violence exercée sur les femmes pour le simple fait d’être femme », peut-on lire dans le préambule à la loi-cadre. La violence exercée par un homme sur une femme dans le couple est donc devenue un délit particulier en Espagne. Et cela constitue une avancée spectaculaire dans un pays qui a longtemps mis de côté les droits des femmes, rappelle la sociologue Glòria Casas Vila¹: « En Espagne, à cause de la dictature de Franco [1939–1975], les femmes avaient peu de droits. Par exemple, jusqu’à la réforme de 1981, elles ne pouvaient pas divorcer. Les mouvements féministes ont réussi à conquérir ces droits basiques, puis à faire voter une loi sur les violences. »
Le féminicide qui a bouleversé l’Espagne
C’est à la suite du féminicide d’Ana Orantes le 17 décembre 1997, que la nécessité d’une telle loi, portée par le PSOE (Parti socialiste ouvrier espagnol), s’est imposée. Ana Orantes avait déposé quinze plaintes contre son mari. Après la prononciation de leur divorce, un juge l’avait obligée à partager le domicile familial avec lui. Quelques jours avant d’être tuée, brûlée vive par son ex-conjoint, Ana Orantes avait raconté dans une émission de télévision ses « quarante ans à prendre des coups ». C’est leur fille de 14 ans qui a découvert le cadavre de sa mère en rentrant de l’école. « Le féminicide d’Ana Orantes a bouleversé la société espagnole », se souvient Flor de Torres, procureure déléguée d’Andalousie à la violence faite aux femmes, au parquet depuis trente ans, dont dix-sept de spécialisation. « Les instances judiciaires n’ont pas su répondre à sa demande de protection. On ne peut pas bien juger de telles violences entre deux affaires de vols. Ces femmes ont besoin de personnels formés qui vont écouter leur parole sans la remettre en cause. »
Dans son bureau, la juge María Concepción de Montoya essaie d’appliquer ce principe, tout en gérant le flux continu des auditions. Ce matin-là, elle entend un témoin dans le cadre d’une instruction : il a vu un agresseur – depuis placé en détention provisoire – jeter de l’essence sur sa compagne. Abordant un autre sujet entre deux renouvellements de mesures d’éloignement, elle se félicite d’une modification de la loi, en 2020 : « À présent, nous sommes également compétentes pour les femmes trans, elles ne sont plus discriminées. » Exit les prérequis tels le traitement médicamenteux ou le changement d’état civil.
Midi. Après quatre heures d’audition, une femme vêtue d’un uniforme blanc de soignante s’assoit en face du bureau de la juge. Ses jambes tremblent. « J’ai un problème avec l’alcool, mon mari m’insulte quand je bois… Il m’a donné une grande baffe, il a dit qu’il voulait me faire interner. » Elle parle fort. « Je vous écoute », lui dit la juge doucement. « Je lutte pour survivre », lâche la trentenaire à bout de souffle. La juge lui propose que son avocat l’emmène en « salle des victimes » ; une pièce avec canapés et jouets d’enfants qui permet aux femmes de se poser quelques heures et de ne pas croiser leur agresseur – dans les faits, seuls deux des trois tribunaux donnent directement accès à cette salle.
Deux jours plus tard, après avoir entendu le conjoint d’une femme violentée, María Concepción de Montoya ouvre le dossier d’un « délit léger ». Elle reçoit d’abord la plaignante, 35 ans, foulard fuchsia autour des cheveux. La procureure est présente par visioconférence.
« Il vous a insultée ? » demande la juge. « Oui, pour que j’avorte. Il m’a appelée jusqu’à onze fois par jour, il est venu à mon travail… » Dix minutes plus tard, la magistrate fait entrer l’ex-conjoint mis en cause. Il s’assoit sur une chaise dans l’encadrement de la porte – pour respecter les règles de distanciation liées à la crise sanitaire. L’homme reconnaît s’être rendu au travail de son ex-compagne ainsi que les appels constants « pour savoir ce qu’elle allait faire, pour qu’elle avorte, ça me rendait fou de pas savoir ». Il est condamné à six mois d’éloignement avec un système de géolocalisation permanente et à cinq jours de « travail au bénéfice de la communauté ». Le taux de condamnation dans les tribunaux spécialisés qui jugent les délits légers était en 2012 de 74 % contre 50 % dans les tribunaux pénaux. D’après un classement établi par le réseau européen de datajournalisme (EDJnet) à partir de données d’Eurostat, l’Espagne est le troisième pays (sur 19) comptant le moins de féminicides conjugaux proportionnellement à la population féminine totale. Par comparaison, la France, se classe au huitième rang². Les actions mises en place semblent donc porter leurs fruits, même si les Espagnoles se déclarant victimes ne sont encore que 27 % à déposer plainte – et seulement 14 % en France.
Chercher les cicatrices
La loi de 2004 a également créé les unités d’évaluation médico-légale intégrale (UVIF) dédiées à la violence de genre. Celle de Malaga est située au sous-sol du palais. On y accède par d’immenses couloirs bleu gris labyrinthiques. Esperanza López Hidalgo, médecin légiste, coordonne une équipe de quatre psychologues, quatre travailleuses sociales et deux médecins légistes, qui s’entretiennent séparément avec la victime, l’agresseur et parfois les enfants. Les juges saisissent uniquement ces unités pour les cas de violences dites « habituelles » (traduction littérale de « maltrato habitual » pour caractériser des faits de violences psychologiques accompagnées de violences physiques, sexuelles ou verbales perpétrées sur plusieurs années). « Cela nous permet d’évaluer la violence psychologique, précise la juge Montoya, et de savoir dans quelles conditions vivent les enfants. » Travaillant en duo, Ana Sánchez, psychologue, et Elena Rodríguez assistante sociale, cherchent « à connaître les antécédents, la dépendance financière, le niveau d’anxiété, le risque de récidives… ». La psychologue évalue aussi la « consistance émotionnelle » et tente de mesurer l’impact psychologique des violences.
Au-dessus d’un grand placard, des ours en peluche surplombent le couloir où se trouve le bureau de la coordinatrice. Ici, la médecin Esperanza López Hidalgo cherche les lésions ou cicatrices sur le corps des femmes, scrute les précédents certificats médicaux et les photos de blessure. « Le patriarcat crée cette idée de supériorité des hommes, c’est donc crucial d’examiner les femmes avec cette perspective de genre… Elles souffrent et sont passées par nombre de bureaux ; on ne doit pas leur causer d’autres préjudices. » Quinze à vingt dossiers sont traités ici chaque mois. « Notre grand défi, c’est la coordination car les victimes sont parfois un peu perdues, avec toutes ces institutions auprès desquelles elles doivent faire des démarches », ajoute Inés Doménech, directrice de l’Institut de médecine légale, ex-coordinatrice de l’unité d’évaluation médicale.
La voix des survivantes
« Perdue. » C’est le sentiment qu’a éprouvé Ana Padial, hôtesse de caisse dans un supermarché, à la suite de la plainte qu’elle a déposée pour menaces en 2011 contre son mari. « Je n’avais jamais été dans un tribunal, j’ai trouvé la justice froide, j’avais l’impression d’être toute petite », se souvient cette femme de 46 ans, qui a subi des violences psychologiques et physiques de la part du père de son fils avec qui elle a vécu vingt ans. Au procès, en 2013, « terrifiée », elle a usé de son droit à ne pas témoigner contre lui ³. « Ils ont pu seulement le condamner pour ce qui était évident : il avait voulu brûler la maison et m’avait menacée. » L’ex-conjoint a été condamné à deux ans de prison ferme.
Échaudée par son expérience du parcours judiciaire, Ana Padial a cofondé en 2013 l’Asociación de supervivientes de violencia de género (Amusuvig, Association des survivantes de la violence de genre) qui accompagne dans leurs démarches 50 à 80 victimes par an. Parmi elles, nombre de « femmes exilées violentées, qui n’ont pas leur famille près d’elles. Quand on arrive face à un·e juge, on a besoin d’empathie, mais on te remplit les mains de prospectus. Personne ne t’explique les choses avec tes mots ou dans ta langue… Pour faire baisser le stress des femmes, nous les informons : on leur dit par exemple qu’un·e procureur·e sera de leur côté, qu’elles pourront demander un paravent au procès pour ne pas voir leur agresseur », détaille Ana Padial, installée à son bureau au siège de l’association, à côté d’une salle dédiée aux enfants pleine de jeux bariolés.
Ana Padial n’est pas la seule à avoir souffert d’un mauvais accueil de la justice. La sociologue Glòria Casas Vila a interrogé 60 femmes victimes entre 2010 et 2015. Si la plupart ont évoqué un accueil correct dans les commissariats, toutes ont relevé « un manque d’empathie » de la justice et une « faible prise en compte de la difficulté de leur situation émotionnelle et de [leur] terreur lorsqu’elles arrivent au tribunal ». La chercheuse précise : « Il y a une violence institutionnelle, empreinte de sexisme et de racisme, même si cela ne remet pas en cause le besoin de tribunaux spécialisés. »
Mieux protéger les enfants
Malgré les avancées qu’a permises la loi, nombre d’organisations féministes alertent sur les améliorations à y apporter. La bénévole Ana Padial milite pour « une équipe de première heure » au tribunal avec un·e psychologue, un·e travailleur·euse social·e, un·e avocat·e et une survivante qui soutiendrait la plaignante du début à la fin et décrypterait le processus judiciaire. Consciente des limites du système, la juge Montoya aimerait quant à elle qu’un·e avocat·e et un·e psychologue soient disponibles pendant les gardes des juges au tribunal « pour prendre en compte le sentiment de culpabilité des victimes, les aider à surmonter leur peur de témoigner ». La parole des survivantes reste encore trop peu prise en compte par la justice, estime l’association Amusuvig. « On dirait que les pouvoirs publics ne veulent pas parler des dysfonctionnements », déplore Ana Padial, qui plaide pour davantage d’échanges entre associations et justice. « On a reçu une femme dont l’ex-conjoint avait fait neuf mois de prison en 2012 pour des violences commises sur elle. Mais il continuait à la menacer, et ses nouvelles plaintes n’aboutissaient pas. En 2018, cet homme a tué sa nouvelle compagne, à Viñuela. Pour notre bénéficiaire et son enfant, ça a été un traumatisme. »
Sagrario Nieto Vera, avocate spécialisée, ex-présidente et militante de l’association féministe Violencia Cero (Violence zéro) souligne de son côté que les stages de sensibilisation pour les auteurs de violence n’ont pas d’effet. La procureure Flor de Torres ne dit pas autre chose : « La réinsertion est un échec. Notre défi est de prendre en charge les hommes violents avec des thérapies effectives pour qu’ils ne transmettent pas leur violence à leurs enfants. »
Concernant la protection des enfants, en 2015, la loi a établi que les mineur·es exposé·es à la violence de genre sont également considéré·es comme victimes. Mais Ana Padial estime que des lacunes subsistent malgré tout : pendant son divorce, elle s’est vu imposer un régime de garde d’un week-end sur deux jusqu’aux 14 ans de son fils. Ce dernier a alors pu demander au juge de ne plus voir son père, qui a finalement perdu ses droits parentaux. « Mon fils a dû subir le comportement de son père pendant des années. Aujourd’hui, il va bien, mais si un jour il est violent, ce sera la faute de la société. »
Il suffit d’assister à une audience pour « divorce contentieux » au tribunal spécialisé, pour constater à quel point le maintien des liens entre des pères reconnus violents et les enfants peut être tenace. Le regard inquiet, une jeune femme vêtue de noir écoute la juge Montoya. Son ex-conjoint, installé à l’autre bout de la salle d’audience est sous le coup d’une ordonnance d’éloignement. « Pour la tranquillité de votre fille et pour que Monsieur contrôle son agressivité, je propose des visites supervisées, déclare la juge. Et si, dans un an, cela se passe bien, nous envisagerons d’accroître ces droits de visite. » La mère secoue la tête d’agacement quand la magistrate demande la poursuite des appels vidéo. « Il voit où je suis via la caméra, il continue de vouloir m’épier. » La juge insiste : « Pour votre fille, c’est important de ne pas rompre la relation avec son père. » Ce dernier devra acheter une tablette à sa fille pour que les appels ne se déroulent plus sur le téléphone de la mère. L’avocate Sagrario Nieto Vera s’en désole : « Il est rare de réussir à suspendre un régime de visite. Et les agresseurs utilisent les enfants pour maintenir le contrôle. »
Le temps trop long de la justice
Au même titre que Violencia Cero et que la plupart des associations féministes du pays, Sagrario Nieto Vera déplore également la surcharge de travail des tribunaux. La moyenne de traitement entre une plainte et un jugement est de quatre ans à Malaga. En février 2021, un cas a été particulièrement révélateur de ce dysfonctionnement : un homme a tenté de tuer son ex-compagne et une amie à elle en leur jetant de l’acide au visage. Une procédure était en cours contre lui pour des violences envers la mère de son fils datant de 2016, pour laquelle il n’a été condamné qu’après la tentative de féminicide, à six mois de prison.
Malgré un budget d’un milliard d’euros sur cinq ans, approuvé par un « pacte d’État contre la violence de genre » en 2017, le manque de moyens se fait sentir. Faute d’effectifs suffisants, les juges spécialisé·es ne peuvent assurer des gardes qu’entre 8 heures et 13 heures. Le reste du temps, elles sont confiées à des juges d’instruction sans spécialisation. Les associations féministes estiment également que la formation des magistrat·es, d’une durée de seize heures, est insuffisante. L’association Violencia Cero et la juge Montoya demandent aussi l’ouverture d’un quatrième tribunal à Malaga. L’arrivée d’un·e juge et de greffièr·es supplémentaires permettrait d’« éviter les soucis avec des juges pas forcément formé·es ».
Élargir le spectre de la loi à l’ensemble des violences (sexuelles, sexistes au travail, etc.), comme le réclame Violencia Cero est une revendication nationale des féministes : « L’agression d’une femme par son voisin n’est pas jugée dans ces tribunaux dans la mesure où ce n’est pas son conjoint, alors qu’il s’agit bien d’une violence de genre », pointe l’avocate Sagrario Nieto Vera. « De plus, les chiffres ne rendent pas compte du nombre réel de femmes assassinées, puisque la belle-soeur, la mère, la fille tuées au même moment que la conjointe ne sont pas comptabilisées dans les statistiques, pas plus que les féminicides de travailleuses du sexe. » La sociologue Glòria Casas Vila complète : « Dans l’affaire de Pampelune (une jeune femme victime de viols par plusieurs hommes,) la plaignante n’a pu bénéficier du statut de victime de violence de genre. Elle n’a donc pas eu accès aux aides sociales et financières dédiées, ça pose vraiment problème. » La chercheuse pointe la possibilité d’une évolution, avec des modèles comme la Catalogne, où la loi régionale de 2008 inclut toutes les violences des hommes, « sans exiger une relation conjugale entre agresseur et victime ».
Mais pour avancer encore, il faudra contrer les conservateurs, issus des rangs du parti libéral Ciudadanos ou du parti néo-franquiste Vox, qui gagnent du terrain et ne cessent de remettre en question la loi-cadre de 2004. Le tribunal suprême, saisi plus de cent fois, a pourtant statué sur la constitutionnalité de cette loi et du traitement juridique différencié pour les femmes. La procureure Flor de Torres appuie : « Quand les femmes ne seront plus violentées et tuées simplement parce qu’elles sont des femmes, on n’aura plus besoin d’une telle loi, mais ça n’est pas le cas aujourd’hui. Et ce n’est pas simplement en Espagne mais aussi en France et partout dans le monde. Cela requiert un principe d’intervention de l’État, une discrimination positive, pour que l’on puisse arriver à une égalité de droits entre les hommes et les femmes. »
*****
1. Autrice de la thèse « Violences machistes et médiation familiale en Catalogne et en Espagne. Enjeux de la mise en oeuvre d’un cadre légal d’inspiration féministe », université de Lausanne, 2018.
2. Voir « Féminicides en Europe : une comparaison entre différents pays », European Data Journalisme Network, 2017.
3. En Espagne, les plaignantes ont la possibilité de refuser de témoigner au procès.