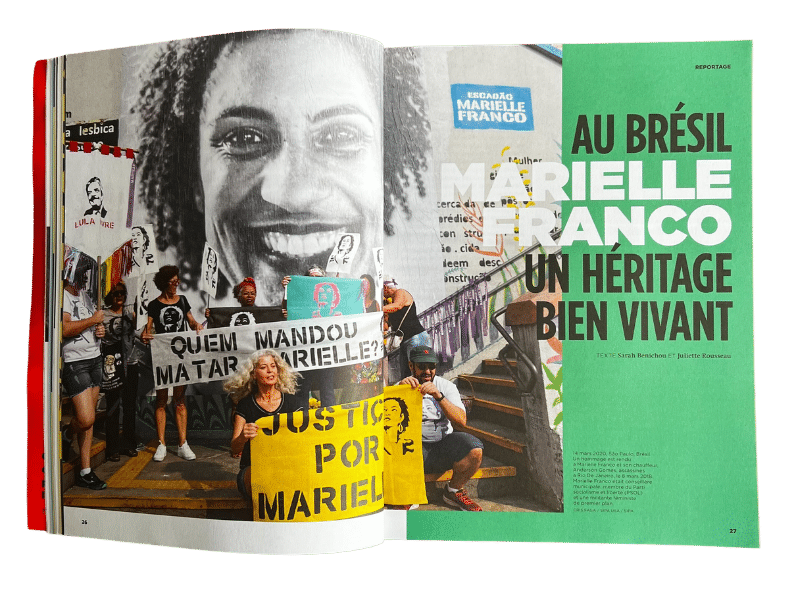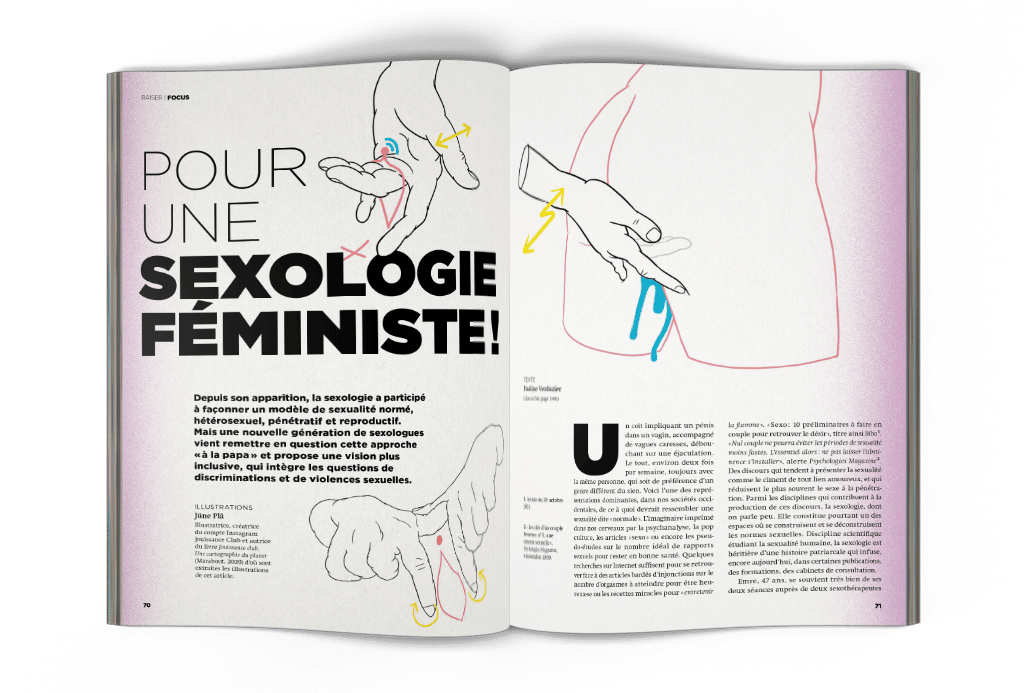En novembre 2025, Belém a accueilli la COP 30, la conférence organisée par les Nations unies sur les changements climatiques : un événement hors norme pour la deuxième plus grande ville de l’Amazonie, capitale du Pará, cet État du nord du Brésil qui détient le taux de déforestation le plus important, et abrite le plus grand cheptel bovin du pays. Un an plus tôt s’est tenu à Belém un autre événement, bien moins médiatisé : la Journée mondiale du véganisme populaire, issu du véganisme, mouvement qui prône un choix de vie éthique consistant à refuser toute exploitation animale, que ce soit dans l’alimentation, l’habillement ou dans le cadre des loisirs (lire notre glossaire).
Depuis deux ans, le 1er novembre est inscrit au calendrier officiel de la ville comme Journée du véganisme populaire, sous l’impulsion commune du collectif Véganisme en mouvement et de la Bancada Feminista, un groupe de conseillères municipales sensibles à la cause animale. En y adossant l’adjectif « populaire », ce mouvement entend promouvoir un véganisme accessible, enraciné dans les savoirs populaires, et articule la lutte pour la libération animale à celle de la justice sociale et de la décolonisation.
Le soir du 1er novembre 2024, à Belém, quelques dizaines de personnes ont pris place dans la salle de l’Armazém do Campo, épicerie et lieu d’organisation politique du Mouvement des travailleur·euses sans terre (MST), mouvement social brésilien apparu au début des années 1980 qui lutte contre la concentration foncière et pour que les paysan·nes brésilien·nes puissent posséder des terres à cultiver. Une table ronde intitulée « Tu as déjà mangé l’Amazonie aujourd’hui ? » exposait les liens de cause à effet entre la consommation de viande et la déforestation de l’Amazonie. Parmi les intervenantes : Michelle Muriel, militante du collectif Véganisme en mouvement, B.onça1Son nom de militante est un jeu de mots entre Beyoncé et « be-onça » – « onça » est le nom du jaguar brésilien qui vit en Amazonie., militante du Mouvement des travailleur·euses sans terre, et moi-même, qui suis cofondatrice de l’Union végane antispéciste au Brésil. Chercheuse en sciences sociales et environnementales, spécialisée en écoféminisme et en antispécisme2L’antispécisme est
un courant de pensée qui remet en question la hiérarchisation des espèces, la domination et l’exploitation des animaux par les humain·es. L’antispécisme affirme que l’espèce à laquelle appartient un animal n’est pas un critère pertinent pour décider de la considération morale qui doit lui être accordée., Michelle Muriel s’est engagée dans le véganisme populaire pour dénoncer le rôle central de l’élevage dans la destruction et la colonisation des terres indigènes : « C’est une prédation sur les territoires qui a pour conséquence d’éliminer des peuples autochtones. Des défenseur·euses de l’environnement sont assassiné·esD’après l’ONG Global Witness, l’Amazonie est l’un des endroits les plus dangereux au monde pour les défenseur·euses de l’environnement : au moins 296 d’entre elles et eux y ont été tué·es entre 2014 et 2022 . Se battre pour l’Amazonie sans regarder le contenu de son assiette, ça n’a pas de sens. » Le Brésil est le deuxième exportateur mondial de produits agricoles et agroalimentaires. L’agrobusiness, dominé par les grandes entreprises du secteur alimentaire (JBS, Marfrig, Cargill, Bunge, etc.), représente 25 % de l’économie nationale. C’est dans ce contexte que le véganisme populaire a trouvé sa place aux côtés des paysan·nes mobilisé·es pour l’accès à la terre.
Élevage et expansion coloniale
La colonisation portugaise au Brésil a imposé un modèle économique et politique fondé sur la concentration des terres, la monoculture, l’esclavage et l’élevage. À leur arrivée, au début du XVIe siècle, les colons ont importé des espèces animales domestiquées – jusque-là inconnues des peuples indigènes, pour qui le concept même d’élevage était nouveau. Les colons ont envahi d’immenses terres et rasé les forêts pour y créer des pâturages, et ont expulsé et exterminé les indigènes. L’élevage n’a pas seulement transformé le paysage : il a été le fer de lance de l’expansion coloniale et de l’accaparement des terres. Cette matrice coloniale structure la société brésilienne.
La dictature militaire brésilienne (1964–1985), régime autoritaire de droite soutenu par les élites économiques et les grands propriétaires ruraux, a violemment réprimé les mouvements sociaux et les paysan·nes en faveur de la réforme agraire. En 1966, le gouvernement fédéral brésilien lance l’opération « Amazonie » : un plan de colonisation et de développement de la région, qualifiée alors d’« enfer vert ». Ce programme visait à attirer, au moyen de subventions et d’incitations fiscales, les investissements privés dans l’élevage bovin et à transférer des paysan·nes sans terre en Amazonie. Cette opération a ouvert la forêt aux intérêts de l’agrobusiness et des multinationales.

La forêt amazonienne a également été victime de l’expansion de la culture du soja. Une variété tropicale mise au point par des agronomes brésiliens dans les années 1990 a permis son développement massif. Destiné principalement à l’alimentation animale (le poulet en est le premier consommateur mondial), le soja s’est surtout étendu dans le sud de l’Amazonie, territoire habité par plus de 80 groupes indigènes. Selon l’entreprise publique brésilienne de recherche agricole, la surface consacrée à la culture du soja est passée de 10 millions d’hectares en 1993 à plus de 47 millions (un peu plus que la surface de la Suède), en 2024.
« Se battre pour l’Amazonie sans regarder le contenu de son assiette, ça n’a pas de sens. »
Michelle Muriel, militante du véganisme populaire
Devenu le premier exportateur mondial de soja, de viande bovine et de poulet, le Brésil paie aujourd’hui le prix social et environnemental de ce modèle agro-exportateur. Le pays connaît l’une des plus fortes concentrations foncières au monde : 1 % des propriétaires détiennent près de 50 % des terres agricoles. Cette expansion agro-industrielle s’accompagne d’une violence structurelle et coloniale : en 2024, d’après le rapport annuel « Caderno de Conflitos no Campo » (Cahier des conflits en milieu rural), 2 185 conflits liés à la terre ont été recensés, touchant principalement les peuples indigènes et les paysan·nes sans terre. Parallèlement, les écosystèmes brésiliens s’effondrent : à ce jour, 59 millions d’hectares de forêt amazonienne ont déjà été détruits pour ouvrir des pâturages, responsables à eux seuls de 90 % de la déforestation dans cette région. C’est pour combattre l’injustice sociale et la catastrophe écologique issues de cette histoire qu’est né le véganisme populaire.

et la marchandisation de la forêt amazonienne, dans lesquelles s’inscrivent les solutions de la COP 30. Crédit : Anne Paq
La montée de l’extrême droite ces dernières années a accéléré les mobilisations. En 2018, à Recife, dans le nord-est du Brésil, entre les deux tours de l’élection présidentielle qui allait porter au pouvoir Jair Bolsonaro, candidat d’extrême droite, nous décidons de créer avec une dizaine d’ami·es véganes un courant du véganisme résolument anticapitaliste et antifasciste, le véganisme populaire, et de fonder un réseau militant pour le porter : l’Union végane antispéciste (UVA). L’année suivante, une première rencontre nationale rassemble 300 participant·es à Recife. Depuis, des dizaines de collectifs antispécistes, issus de différentes régions du pays, ont rejoint l’UVA pour promouvoir le véganisme populaire sur tout le territoire. Lutte pour la libération animale, le véganisme populaire s’attache à identifier les obstacles structurels à l’abolition de l’exploitation animale et se bat pour que les humain·es s’émancipent de cette relation avec les animaux. Le mouvement relie ainsi l’antispécisme aux luttes féministes, écologistes et anticoloniales.

Mais au sein des mouvements sociaux de gauche, le véganisme fait l’objet de critiques. Pour certain·es, les changements individuels, comme le régime alimentaire voulu par les véganes, ne sauraient constituer une réponse efficace aux injustices sociales structurelles. Nous répondons que personne n’oserait avancer cet argument pour justifier le refus d’agir individuellement contre le racisme ou le sexisme. En refusant de participer à ce qui est combattu et dénoncé publiquement, nous, les véganes, entendons faire preuve de cohérence politique.
Octobre 2024. Rio Branco, capitale de l’État amazonien de l’Acre, à l’ouest du Brésil, s’embrase. Depuis plusieurs semaines, la ville est plongée dans la fumée : l’air a atteint un niveau record de pollution. Le 5 octobre, un appel à manifester est lancé par des organisations environnementalistes locales pour dénoncer les incendies, déclenchés principalement par les éleveurs qui déboisent illégalement la forêt pour ouvrir de nouveaux pâturages. Sur une banderole, on lit : « La fumée est le symptôme, l’agrobusiness est la maladie ». Tácila Matos, étudiante en journalisme, issue d’une communauté ribeirinha (communauté traditionnelle qui vit au bord des rivières), est venue manifester pour dénoncer l’exploitation animale : « Dans mon territoire, l’influence des éleveurs de bétail est immense. Notre culture alimentaire a été transformée, et aujourd’hui nous mangeons du fromage, du jambon, des barbecues de bœuf… Notre relation traditionnelle avec la nature et les animaux est vue comme un archaïsme à dépasser. Nous nous éloignons de la forêt, de notre histoire et de nos aliments traditionnels. Nous devons aider les gens à se rappeler ce qu’est vraiment notre tradition, et réparer notre relation ancestrale avec la forêt et les autres animaux. »
Véganisme et féminisme : même combat
Runi Garcia, éducatrice sociale, fait partie du collectif végane et féministe Manas na Rua, membre de l’UVA, depuis sa création il y a cinq ans. Comme Michelle Muriel et Tácila Matos, elle articule lutte anticoloniale, lutte contre l’exploitation animale et lutte féministe. « Dans notre territoire, nous avons subi un processus profond de colonisation des corps et des esprits. À cause de la concentration foncière agricole et de la déforestation provoquée par l’élevage, il ne reste presque plus de terres qui permettent aux populations locales de pratiquer leur mode de vie traditionnel. » Critiquant « le refus de reconnaître les conséquences de nos choix alimentaires sur les animaux et l’environnement », elle estime que, sans la pratique du véganisme populaire, « l’avenir devient impossible. »
33 millions
de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire modérée ou sévère au Brésil en 2023
À plus de 5 000 kilomètres de Rio Branco, un samedi d’octobre 2024, le collectif Manas na Rua prépare la nourriture qui sera distribuée dans les rues de Natal, capitale de l’État du Rio Grande do Norte, au bord de l’océan Atlantique. Tous les samedis, ce collectif de femmes engagées « dans la lutte contre l’insécurité alimentaire, pour le véganisme populaire et le féminisme » propose à environ 200 personnes à la rue ou en situation de grande précarité des repas d’origine végétale, respectueux de la culture alimentaire de la région, avec des ingrédients traditionnels du territoire. En 2023, le Brésil comptait plus de 33 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire modérée ou sévère, selon l’Institut brésilien de géographie et de statistique.
Au cœur de la lutte contre la faim, le véganisme populaire se veut autant un enjeu de santé communautaire que de justice alimentaire. Selon la militante Runi Garcia, « ce sont surtout les gens dans les quartiers populaires, les favelas et les zones rurales qui meurent à cause d’une alimentation pauvre en végétaux, centrée sur la viande et les produits ultratransformés ». En 2017, selon une étude publiée en 2019 par The Lancet, une mort sur cinq dans le monde était liée aux habitudes alimentaires, dont une consommation insuffisante de céréales complètes et de fruits.

Crédit : Anne Paq.

Crédit : Anne Paq

Crédit : Anne Paq

Crédit : Anne Paq
Si la santé peut être la porte d’entrée vers le véganisme, la réflexion s’articule dans une perspective plus globale pour ce qui est du véganisme populaire. Larissa Pontes s’est d’abord intéressée au régime végétarien en raison des soucis de santé de sa mère. Aujourd’hui, elle explique qu’elle « pratique le véganisme par solidarité envers les humain·es, les non-humain·es, et les générations futures ». Pour la sociologue, le spécisme, parce qu’il hiérarchise les corps selon leur espèce, reproduit les logiques d’oppression du racisme, du sexisme et du colonialisme. Estimant que l’antispécisme doit être au cœur des luttes sociales, elle souligne que « les Amazoniennes subissent directement et plus durement les conséquences de l’expansion des pâturages sur le climat ». Elles perdent l’accès à l’eau potable et à leurs moyens de subsistance traditionnels, tout en portant la charge de nourrir leurs familles dans des conditions de plus en plus précaires.

Manas na Rua fait partie de l’Union végane antispéciste. Crédit : Anne Paq
Pour les défenseur·euses du véganisme populaire, mettre en lumière les injustices climatiques subies par les femmes permet d’articuler le féminisme et le véganisme, qui ont en commun de remettre en cause les systèmes de domination fondés sur la hiérarchisation et l’exploitation des corps – féminins ou non humains. Le féminisme dénonce la subordination des femmes et des personnes minorisées par le genre ; l’antispécisme, celle des animaux, traités comme des ressources ou des objets sans droits propres. Dans les deux cas, il s’agit de déconstruire les idéologies qui naturalisent ces oppressions.

dont les femmes d’Amazonie subissent le plus durement les conséquences. Crédit : Anne Paq
Les femmes sont nombreuses à porter la lutte antispéciste au Brésil. Pour Daniela Rosendo, docteure en éthique et membre du Comité d’Amérique latine et de la Caraïbe pour la défense des femmes (Cladem), cela s’explique par une expérience commune et historique de la domination. « En étant historiquement assignés au travail de la reproduction de la vie et de soin, nos corps subalternisés peuvent à la fois refuser ces assignations et tisser des solidarités avec d’autres corps dominés. C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles les femmes et les personnes LGBTQIA+ sont si présentes dans le mouvement antispéciste. »
Au Brésil, contrairement à ce qui se passe en Europe, associer les femmes à la nature n’est pas perçu comme un discours essentialisant. Cette différence s’explique par l’influence des luttes indigènes et par le cadre de pensée anticolonial. Le colonialisme, en dévalorisant la nature pour se justifier, a imposé l’idée qu’elle devait être dépassée. Dès lors, s’en rapprocher devient un geste de décolonisation des imaginaires, des corps et des modes de vie. Loin d’un romantisme naïf, il s’agit d’une analyse matérialiste, qui s’inscrit dans une expérience sociale vécue et concrète : ce sont les femmes qui, dans les communautés rurales, indigènes et quilombolas3Membres de communautés de descendant·es d’esclaves noir·es africain·es qui ont fui le travail forcé pour former des villages en pleine nature., portent la responsabilité de préserver l’eau, les semences, les forêts et l’alimentation de leurs familles. Le soin et la défense de la nature sont des actes profondément rationnels – c’est la condition même de la vie.
« Les Amazoniennes subissent directement et plus durement les conséquences de l’expansion des pâturages sur le climat. »
Larissa Pontes, sociologue

Ici, elle reçoit des ami·es. Crédit : Anne Paq
Pour faire le lien entre l’alimentation et l’effondrement climatique, l’UVA organise sa troisième rencontre nationale du 31 octobre au 2 novembre 2025 à Belém, une semaine avant la COP 30, qui a totalement exclu de son programme la question animale. Pour Michelle Muriel, qui fait partie de l’équipe organisatrice de la rencontre, « les thèmes centraux de la COP 30, comme le marché du carbone et l’élevage dit “régénératif”, incarnent parfaitement la logique capitaliste de marchandisation de la vie dans la forêt amazonienne : sous couvert de solutions écologiques, on perpétue les mécanismes d’exploitation qui détruisent les écosystèmes. Les antispécistes affirment qu’il n’y aura pas de réponse réelle à l’effondrement climatique sans sortir de l’exploitation animale. »
Quelques jours plus tard, à Belém, un autre espace de lutte devrait prendre forme. Organisé en parallèle aux COP, le Sommet des peuples est un grand rassemblement de la société civile, où s’exprime la voix des communautés les plus affectées par le changement climatique. L’UVA a été invitée à concevoir des options véganes pour chaque repas servi pendant l’événement, qui doit durer cinq jours et réunir environ 10 000 personnes. Une manière de montrer que le véganisme populaire ouvre la voie à une écologie qui refuse de séparer justice sociale, justice climatique et justice animale.