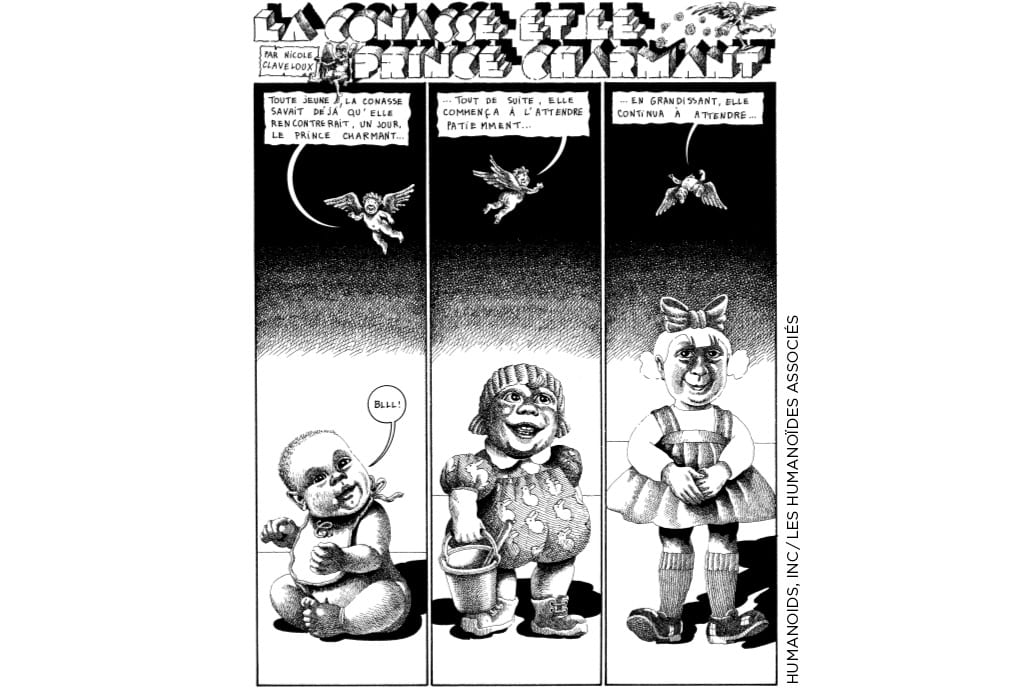Dans une vaste salle du musée de Capodimonte, sur les hauteurs de Naples, la lumière est orientée sur un tableau représentant Judith décapitant Holopherne, un épisode de l’Ancien Testament. Peinte en 1613, l’œuvre montre une jeune servante concentrée, légèrement dans l’obscurité, qui surplombe Holopherne, allongé et agité.
L’épisode de la décapitation d’Holopherne par Judith a inspiré de nombreux artistes. La plupart des compositions réalisées par des hommes ont dépeint la servante en vieille dame complice de sa maîtresse, mais ne participant pas activement au meurtre du personnage biblique, roi d’Assyrie. Celle qui a choisi de faire de cette scène un acte de sororité s’appelle Artemisia Gentileschi. Née à la toute fin du XVIe siècle, elle est une représentante émérite de la peinture baroque. Nombre de critiques d’art contemporain ont souligné le réalisme violent de la toile de cette artiste italienne. Pourtant, à la même époque, des hommes, comme l’Espagnol José de Ribera (1591–1652), alors célèbre figure de la peinture napolitaine, ont également peint des toiles sombres et crues représentant des visages diaboliques et de la chair nue, vieillie, ensanglantée. Si l’on souligne à l’envi la dimension sanglante du tableau d’Artemisia Gentileschi, c’est sans doute parce que celle-ci est une femme, et qu’elle a brisé les codes auxquels devaient se plier les femmes peintres à cette époque : on attendait d’elles des natures mortes ou des scènes de vie domestique.

Royal Collection Trust, château de Windsor, Londres, Royaume-Uni.
Crédit : ROYAL COLLECTION TRUST / © HIS MAJESTY KING CHARLES III, 2025 / BRIDGEMAN IMAGES
Une maîtrise parfaite du clair-obscur
Je suis restée figée en contemplant Judith décapitant Holopherne. Je me suis perdue dans ses tons sombres, ses visages expressifs, ses beaux drapés. Je suis journaliste et peintre, et le procédé intime de la confection d’une œuvre me fascine. J’ai tenté d’imaginer la façon dont Artemisia Gentileschi avait cheminé dans la réalisation de ce tableau : combien de temps ce travail colossal lui a‑t-il pris ? De quoi cette artiste s’est-elle nourrie à une époque où le voyage, source d’inspiration, était limité par les contraintes des déplacements ? Je suis à la fois impressionnée par la technique de la peinture à l’huile – pratique physique, épuisante, enivrante, qui nécessite des années, parfois une vie entière, pour être totalement maîtrisée – et captivée par les créateur·ices qui parviennent à faire jaillir sur leurs toiles leurs sentiments les plus profonds. L’œuvre d’Artemisia Gentileschi se veut le reflet de la violence du monde qui l’entoure. Sous son pinceau, le clair-obscur – procédé typique de la peinture à l’huile, qui rend la complémentarité de l’obscurité et de la lumière plus perceptible que jamais – est maîtrisé à la perfection. Artemisia Gentileschi s’inspire du caravagisme, courant pictural populaire de son époque, mettant justement en avant les dualités de lumière et d’ombre. Il doit son nom à Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610), l’un des peintres les plus célèbres de son siècle, et proche du père d’Artemisia Gentileschi, peintre lui aussi.

Crédit : PHOTO12 / ALAMY / ICP, INCAMERASTOCK
Pour esquisser la vie de cette artiste morte il y a presque quatre siècles, je dois me fier aux seuls documents existants : la soixantaine de tableaux expertisés aux mains de musées ou collectionneur·euses privé·es, leur signature et date, ses lettres. Il me paraissait aussi important de partir sur les traces des lieux qui l’ont inspirée… Naples abrite plusieurs de ses célèbres toiles, des scènes bibliques ou mythologiques, ainsi que des portraits de nobles exposés dans les musées. Au monastère de Santa Chiara, derrière les colonnes recouvertes de faïence entre les orangers, je tombe sur la Madeleine pénitente, présente à Naples à l’occasion de l’exposition « Artemisia Gentileschi, un grande ritorno a Napoli dopo 400 anni ». C’est l’un de ses chefs‑d’œuvre.
La peintresse est arrivée en 1630 dans cette ville prospère de Campanie, alors sous domination espagnole. Elle y a vécu la majeure partie de son existence jusqu’à sa mort. Sur la place Caritas, où se trouvait probablement son atelier, fourmillaient les garzoni, ces apprentis qui œuvrent dans les ateliers, dont le sien. À cette époque, outre la ou le signataire de la toile, plusieurs artistes participaient à l’élaboration d’un tableau, même si, selon la logique idéalisée du génie, la mythification d’un·e auteur·ice unique a tendance à primer dans les récits.
Le Vésuve surplombe la baie de Naples. Les éruptions passées du volcan ont terrorisé les habitant·es, comme en 1631, un an après l’arrivée d’Artemisia Gentileschi. Il donne un caractère particulier à la ville qui compte aujourd’hui 900 000 habitant·es : face à ce danger qui la menace, elle dégage comme un sentiment d’empressement. Naples est assurément une ville de contrastes. Ce sont peut-être toutes ces dualités, les ténèbres et les lumières, le moderne et l’antique, l’étrange tourbillon de la vie et de la mort qui ont attiré les « caravagistes ». Ce n’est toutefois pas ici qu’Artemisia Gentileschi a fait ses premières armes, mais à Rome, où elle naît en 1593.
Élevée dans un univers masculin après avoir perdu sa mère à 12 ans, elle grandit dans la Ville éternelle avec ses trois frères et son père, le Toscan Orazio Gentileschi. Il la cloître dans son atelier imprégné de térébenthine en la faisant poser pour lui. La jeune Artemisia Gentileschi connaît la peinture avant d’apprendre à lire et écrire : elle en fait son langage.

Collection du comte de Schönborn, château de Weissenstein, Pommersfelden, Allemagne.
Crédit : AKG-images
Dans ses premières toiles, on peut déjà observer l’une des constantes de son œuvre : des compositions dans lesquelles les femmes occupent une place centrale. En 1610, elle peint l’un de ses premiers tableaux, une représentation de la parabole biblique de Suzanne et les vieillards. Ce passage de l’Ancien Testament, dont elle tirera plusieurs tableaux au fil de sa vie, conte l’histoire de Suzanne, espionnée dans son bain par deux vieillards qui, après qu’elle refuse leurs avances, l’accusent d’adultère et la font condamner à mort. Elle sera sauvée par le prophète Daniel. Jusque-là, dans les représentations de cet épisode, Suzanne était mise en scène par les peintres masculins dans une pose sensuelle, vulnérable ou l’air intimidé face aux deux vieillards qui la harcèlent. Artemisia Gentileschi pousse son tableau dans une autre direction : sous son pinceau, « Suzanne ne se laisse pas faire. Elle ne cache pas ses formes, analyse Patrizia Cavazzini, chercheuse associée à la British School de Rome. Car Artemisia Gentileschi avait l’avantage de pouvoir s’inspirer de son propre corps, alors qu’il était interdit aux hommes de faire poser une femme nue ».
Un corps violenté
Artemisia Gentileschi est formée à la peinture par son père, un homme obsédé par la question de l’honneur. La relation qui les lie influence sa trajectoire. Orazio Gentileschi voit dans le talent précoce de sa fille l’opportunité de faire rayonner son patronyme. Il décide de confier l’éducation artistique d’Artemisia à son ami, le peintre Agostino Tassi. Celui-ci viole la jeune peintresse, alors âgée de 17 ans. Il promet de l’épouser, comme le veulent les codes de l’époque, afin que la réputation de celle-ci soit sauve. Mais Tassi ne tient pas sa parole. Humilié par ce désengagement, Orazio Gentileschi décide de porter plainte auprès du tribunal papal pour le viol subi par sa fille, en expliquant que c’est lui qui a été victime de ce qu’il appelle un « assassinat ». Le crime est qualifié de stupro qualificato, soit la défloration avec violence, aggravé d’une promesse de mariage non tenue. Le procès affecte profondément Artemisia Gentileschi, d’autant qu’il défraie la chronique, car il inclut des puissants de l’époque : le peintre Tassi est un intime du mécène Scipione Borghese, lui-même proche du pape.
Au cours de l’instruction, qui se tient de mars à novembre 1612, Artemisia Gentileschi doit prouver son innocence. Outre un examen gynécologique, il lui faut subir une séance de torture, celle-ci étant, selon les religieux de l’époque, révélatrice de la vérité. Ses mains de peintre sont soumises aux sibilli, supplice consistant à passer une corde entre les doigts et à serrer au risque de briser les os. Elle ne flanche pas et répète les faits : Agostino Tassi l’a violée. Ce dernier est finalement condamné à cinq ans d’exil hors des États pontificaux – peine qu’il n’aurait jamais exécutée, puisqu’il n’a probablement pas quitté Rome. La condamnée, en réalité, c’est elle. Un mariage avec Pietro Antonio Stiattesi, un peintre modeste, est arrangé par son père, toujours soucieux de sa réputation. L’union permet à Artemisia Gentileschi de reprendre la peinture. Humiliée à Rome, elle choisit de s’exiler à Florence vers 1614. Elle y aura quatre enfants, dont trois morts en bas âge, même si peu de biographies de la peintresse mentionnent ces pertes tragiques, à une époque où la mortalité infantile est élevée. Aujourd’hui encore, on en sait très peu sur son troisième enfant, le seul à avoir survécu : nommée Prudenzia, elle est également devenue peintresse.
En 1616, Artemisia Gentileschi entre à l’Académie des arts du dessin de Florence1L’Accademia delli Arti del Disegno, créée en 1563, est la première académie de dessin en Europe, et Artemisia Gentileschi est la première femme à y être intégrée. : c’est son sésame pour la liberté. Le prestige de l’école lui permet de voyager – qui plus est sans son mari – et de faire des affaires. Elle se déplace, toujours en quête de commandes, à Venise, Bologne et Naples. Forte personnalité, dotée d’une véritable capacité à se constituer un réseau, douée pour le négoce – même si elle est constamment endettée, Pietro Antonio Stiattesi ayant la réputation d’être plus dépensier que ne le permettent les rentrées financières aléatoires du couple –, Artemisia Gentileschi réussit à contourner la règle de l’époque, qui impose à toute femme la tutelle d’un homme.
Au XVIIe siècle, les femmes n’évoluent dans la peinture qu’en tant qu’objets, très rarement en tant que créatrices. Les hommes qui dominent les sphères de pouvoir excluent les femmes et invisibilisent les rares qui y accèdent. Elles sont les modèles des artistes, les amantes, les prostituées des « génies ». « [Les femmes] ont longtemps été privées d’accès aux formations à l’art, aux ateliers, aux beaux-arts, etc. La formation familiale – auprès du père majoritairement – a souvent été le commencement. L’histoire des artistes femmes est avant tout une histoire “relationnelle”, explique Charlotte Foucher Zarmanian, docteure en histoire de l’art. C’est plutôt comme femme de, fille de, mère de, élève de, etc., qu’elles sont entrées dans les récits historiques. En Italie, on ne parlait pas d’artistes mais de virtuoso, virtuosa, un terme qui fait référence à ce qui est masculin » puisqu’il dérive de vir, « homme » en latin.

Collection du Musée d’art de Saint Louis, Missouri, États-Unis.
Crédit : COLLECTION OF SAINT LOUIS ART MUSEUM
Malgré la fermeture de ce milieu aux femmes, Artemisia Gentileschi se montre déterminée à s’y imposer, probablement motivée par les perspectives d’autonomie ainsi offertes. Même si à l’époque, être peintre, c’est être au service des puissant·es : ce sont elles et eux qui commandent des toiles dépeignant des scènes de la Bible, des portraits élogieux ou des paysages. Ce sont elles et eux, aussi, qui protègent les artistes. Dans cet univers très concurrentiel, ces dernier·es entretiennent des relations de complicité autant que de jalousie et de compétition. Elles et ils se trahissent, s’empoisonnent, s’entretuent dans les ateliers, les tavernes ou les bordels. Il faut coûte que coûte séduire les commanditaires. Dans cette Italie de la Contre-Réforme2Face à la popularité grandissante du protestantisme au XVIe siècle en Europe, l’Église catholique réagit en lançant la Contre-Réforme, un mouvement de réaffirmation de son dogme et de sa puissance (qui passe notamment par de nombreuses commandes architecturales et artistiques)., l’Église cherche à rayonner, en louant à prix fort ces mains d’or. Artemisia Gentileschi aura du mal à convaincre les religieux, qui lui préfèrent les hommes. Mais elle parvient à avoir pour client·es des rois, reines, duchesses, ducs et autres mécènes : à Florence, par exemple, la grande-duchesse Christine de Lorraine, épouse du grand-duc de Toscane Ferdinand Ier de Médicis, apprécie beaucoup ses toiles.
Les pièges de la postérité
Emportée par une épidémie de peste aux alentours de 1656, Artemisia Gentileschi tombe dans l’oubli, comme d’autres caravagistes. Ce n’est qu’au milieu du XIXe siècle que plusieurs ouvrages, signés de femmes, remettent en lumière son parcours. Un siècle plus tard, l’exposition itinérante internationale « Women Artists 1550–1950 », montée par les historiennes de l’art Ann Sutherland Harris et Linda Nochlin aux États-Unis en 1976, marque le début d’une émergence publique de la thématique des femmes artistes. Aujourd’hui, « il y a un phénomène d’hypervisibilisation des femmes dans l’art, beaucoup d’expositions sur les artistes femmes, mais parfois par opportunisme, estime Charlotte Foucher Zarmanian. Deux registres sont souvent mis en œuvre pour parler d’elles : soit la victimisation (“Oh, la pauvre, comme elle a dû se battre pour y arriver !”), soit l’héroïsme, ce qui leur donne un caractère exceptionnel. On va aussi souvent les appeler par leur prénom (et non leur nom) ». Après des siècles d’oubli, Artemisia Gentileschi est aujourd’hui l’une des rares peintresses à bénéficier d’une médiatisation importante, à la hauteur de certains de ses contemporains masculins. Non sans être exposée aux écueils soulignés par Charlotte Foucher Zarmanian.
Certain·es curateur·ices font d’elle une légende, dont le trait artistique serait indissociable de son viol. L’importance de cet épisode doit toutefois être questionnée. Certaines interprétations le tirent vers la métaphore : les traits d’Holopherne décapité seraient ceux d’Agostino Tassi, et Judith une image d’Artemisia. Cela n’a pas été démontré, mais le récit est attrayant. Parallèlement, la violence subie par Gentileschi sert souvent de motif explicatif aux aspects sanglants de son art. Il s’agit là d’une analyse à double tranchant : le viol tend à enfermer la peinture d’Artemisia Gentileschi dans une unique grille interprétative. « Il est évident que cet épisode dramatique (comprenant le viol, le procès, la torture) n’a pu que marquer profondément sa jeunesse, sa vie, et donc sa personnalité et son art. Cela dit, il est hypothétique de “quantifier” cet effet. Bien des artistes du mouvement caravagesque […] ont peint des scènes extrêmement violentes », estime Pierre Curie, conservateur au musée Jacquemart-André, qui a abrité au printemps 2025 l’exposition « Artemisia, héroïne de l’art ».
La prise en compte des violences subies par la peintresse questionne également les féministes, comme celles du collectif italien Bruciamo Tutto (Brûlons tout) : en 2024, ce groupe s’est insurgé contre les choix faits pour l’exposition Artemisia Gentileschi. Courage et passion proposée au Palazzo Ducale (palais des Doges) de Gênes. Elles ont recouvert de tissu noir trois tableaux d’Agostino Tassi, installés aux côtés des œuvres d’Artemisia Gentileschi dans un narratif plaçant les œuvres de la victime à côté de celles de son agresseur. Les militantes de Bruciamo Tutto ont aussi critiqué la mise en scène voyeuriste conçue par le commissaire Constantino D’Orazio : une chambre obscure avec un lit, un fond sonore fait de phrases prononcées par Gentileschi lors de son procès et repris de manière théâtrale par une voix féminine. Des universitaires et l’association féministe Non una di meno (Pas une de moins) ont appelé dans une lettre ouverte à la fermeture de ce que les signataires appellent la « salle du viol » et au « retrait de la librairie du Palazzo de gadgets contenant des citations du violeur Agostino Tassi, à l’instar de “J’étais un ministre de mon mal” ». Le musée s’est alors défendu de tout sensationnalisme.

pour dénoncer la présence d’œuvres de l’homme qui l’a violée à côté des siennes.
Crédit : MARGHERITA DAMETTI
Ce qui se rejoue en creux à travers une telle affaire, c’est le débat sur la place des éléments biographiques dans la construction d’une œuvre. Victime d’un viol, puis d’un procès d’une immense violence, Artemisia Gentileschi a déployé, dans un milieu très concurrentiel, le talent et l’entregent nécessaires pour que la peinture lui assure une autonomie financière ; elle possédait en plus la singularité artistique qu’il faut pour accéder à la postérité. Et c’est sans doute dans ce mélange indémêlable de clairs et d’obscurs qu’il faut concevoir la complexité d’un tel parcours.
Artemisia Gentileschi en quelques dates
8 juillet 1593
Naissance à Rome
1610
Réalisation de son premier tableau Suzanne et les vieillards
1611
Violée par le peintre Agostino Tassi
1612
Mariage avec Pietro Antonio Stiattesi
1612–1613
Réalisation du tableau Judith décapitant Holopherne
1614
Installation à Florence
1630
Installation à Naples
1640
Réalisation de son troisième tableau Madeleine pénitente
1656
Décès d’Artemisia Gentileschi, probablement de la peste