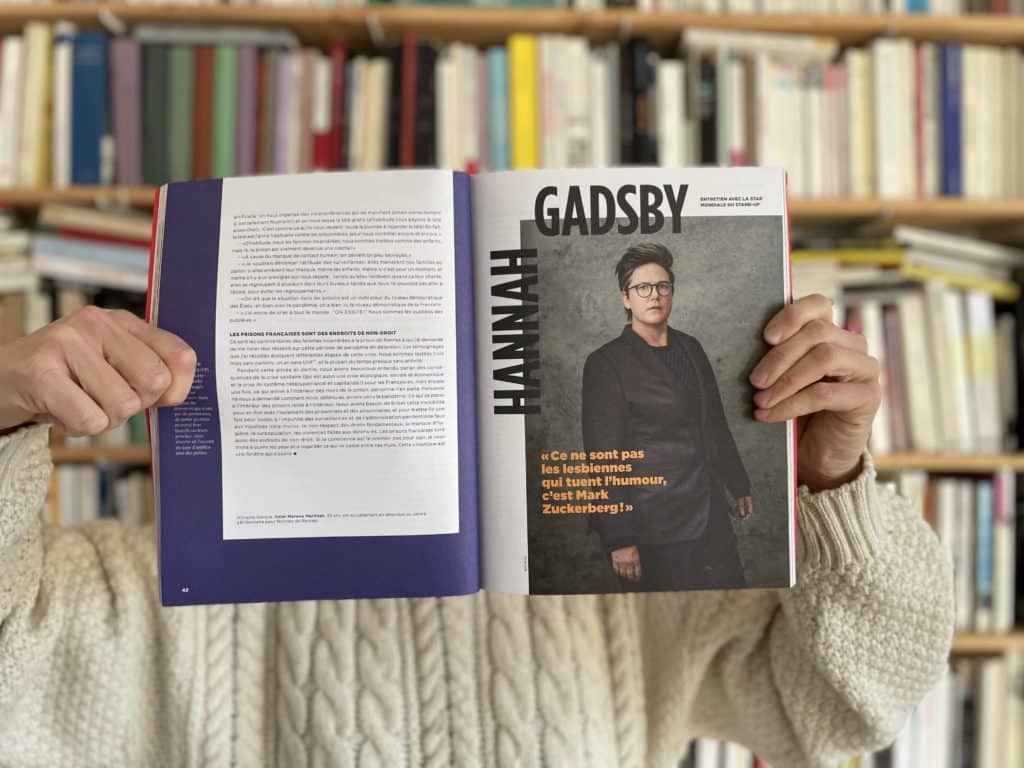L’élection de Donald Trump en novembre 2024 a été un choc pour de nombreuses personnes, aux États-Unis et dans le monde, alors que la candidature de la démocrate Kamala Harris avait suscité un fort enthousiasme. Comment analysez-vous ce résultat ?
On n’aurait pas dû supposer que le Parti démocrate gagnerait ces élections. On pourrait passer des heures à parler de son incapacité à répondre aux besoins des travailleurs et des travailleuses à une époque où les richesses sont de plus en plus concentrées entre les mains des classes supérieures. Le Parti démocrate est dirigé essentiellement par une élite, c’est-à-dire par des gens qui n’ont pas conscience que le capitalisme mondial a détruit la possibilité pour un grand nombre de personnes de vivre une vie décente.
Cette élection a été perdue parce qu’on n’a pas réfléchi aux liens entre le capitalisme mondial – qui est aussi un capitalisme racial – et l’hétéropatriarcat. En tant que membre honorifique du syndicat international des dockers 1 L’International Longshore and Warehouse Union, qui défend les intérêts des ouvriers portuaires aux États-Unis, est en première ligne dans les luttes antiracistes et décoloniales, en refusant par exemple de décharger des bateaux venant d’Israël., je suis profondément déçue de voir le Parti démocrate se détourner des ouvriers et des ouvrières. Je n’ai jamais présumé que l’élection de Kamala Harris serait à elle seule une victoire. Ma position était de voter pour elle pour, une fois qu’elle serait élue, faire pression sur elle pour infléchir sa politique.
Pensez-vous qu’il faille analyser l’élection de Donald Trump comme une victoire de l’homme blanc et de la suprématie blanche ? La campagne de Kamala Harris était axée sur les droits reproductifs, mais cela n’a pas été suffisant pour l’électorat des femmes blanches. Comment pensez-vous que le genre a joué un rôle dans cette élection ?)
À bien des égards, c’est une victoire tactique de la suprématie blanche. Mais je ne pense pas qu’il s’agisse d’une victoire définitive. Le virage à droite et la répression accrue des minorités que nous avons vécue ces dernières années est une réaction de l’ultradroite face à une prise de conscience mondiale de ce racisme et de cette suprématie blanche comme phénomènes structurels ainsi que de la nécessité de les remettre en question.
Le patriarcat a par ailleurs été une force dévastatrice dans cette élection. Mais faire entrer les femmes dans l’arène électorale n’est pas le seul moyen de renverser la situation. J’ai toujours regardé avec méfiance l’idée selon laquelle des personnes, du simple fait de leur identité raciale ou de genre, seraient susceptibles de provoquer des changements massifs. Ces prédictions ne tiennent pas compte du pouvoir de l’organizing 2 Aux États-Unis, l’organizing est une méthode de mobilisation communautaire visant à rassembler des individus autour d’intérêts communs pour exercer un pouvoir collectif et obtenir des changements sociaux, économiques ou politiques.. C’est grâce à ces mobilisations structurées au fil des décennies, de centaines d’années même, que les femmes noires sont à même d’occuper une place centrale.
« La répression accrue des minorités est une réaction de l’ultradroite face à une prise de conscience mondiale du racisme et de la suprématie blanche comme phénomènes structurels. »
Pensez-vous que l’élection de Donald Trump fasse courir un risque sérieux à la démocratie états-unienne ?
Cela fait longtemps que les États-Unis prennent une direction qui va à l’encontre d’un développement de la démocratie. Les débats sur l’utilisation du mot « fasciste »3 Lancé dès le premier mandat de Donald Trump, en 2017, le débat a resurgi lors de la dernière campagne présidentielle après que plusieurs anciens collaborateurs du président élu ont estimé qu’il correspondait à la définition de « fasciste ». Une accusation reprise par la candidate démocrate, Kamala Harris. nous amènent à nous interroger sur la nature de notre système. Les États-Unis prétendent répandre la démocratie à travers le monde, mais cet impérialisme sert d’abord une volonté d’expansion du capitalisme. Nous devons prendre au sérieux la menace du fascisme et la montée des leaders d’extrême droite, non seulement aux États-Unis, mais aussi au Brésil, aux Philippines, en Italie, et en France, bien sûr. Nous devons aussi repenser ce que l’on entend par « démocratie » puisque ce mot est utilisé de façon si désinvolte.

Face à la montée des extrêmes droites dans le monde, quels sont les outils pour résister ? Y a‑t-il encore une place pour l’espoir ?
Oui, sans espoir, cela n’a aucun sens de continuer à lutter. Mariame Kaba 4 Mariame Kaba est une autrice et activiste états-unienne engagée dans les mouvements pour l’abolition des prisons, la justice raciale et la justice de genre.l’a parfaitement formulé en disant que « l’espoir est une discipline ». C’est une exigence absolue de la lutte et un élément essentiel de la mobilisation contre la menace imminente du fascisme. Trouver des moyens de générer de l’espoir relève de notre responsabilité d’activistes.
La prise de conscience du racisme structurel s’est intensifiée en 2020 5Après le meurtre raciste de George Floyd par un officier de police aux États-Unis, le mouvement Black Lives Matter a pris une ampleur inédite à travers le monde.en pleine pandémie. Ce qui est remarquable dans cette période, c’est qu’un grand nombre de personnes qui n’avaient probablement pas réfléchi sérieusement aux luttes antiracistes ont commencé à développer une conscience collective de cette oppression. Nous devons être conscientes et conscients de la manière dont de tels événements nous font avancer et être prêt·es à tirer parti des événements imprévus.
Aujourd’hui, un mouvement réactionnaire tente de contrer cette évolution. Des livres sont censurés ou menacés d’être brûlés sur la place publique, et certain·es exercent des pressions pour changer les programmes dans les écoles primaires, les lycées, les collèges et les universités [lire l’encadré ci-dessous].
Les plus diplômé·es étant les plus susceptibles de comprendre les racines historiques esclavagistes et coloniales du racisme structurel et de voter contre Trump, elles et ils représentent une menace pour les promoteurs du fascisme. L’éducation est donc un espace de lutte très important. C’est pourquoi j’entrevois des possibilités de victoires à l’avenir.
Les livres LGBT+, nouveau front des guerres culturelles aux États-Unis
En septembre 2023, une vidéo prétend montrer deux sénateurs républicains de l’État du Missouri, Bill Eigel et Nick Shroer, se livrant à un autodafé au lance-flammes. Elle a été vue des millions de fois aux États-Unis en quelques jours. L’information a été démentie – il s’agissait de cartons et non de livres – mais cela ne l’a pas empêchée de devenir virale. Bill Eigel a par la suite déclaré sur X : « Si vous apportez des livres wokes et pornographiques dans les écoles du Missouri pour essayer de laver le cerveau de nos enfants, je les brûlerai. » En 2022, dans cet État, une loi a été adoptée qui bannit des bibliothèques scolaires des livres considérés comme « sexuellement explicites » et qui cible en réalité les ouvrages traitant des violences sexuelles, de l’avortement, de la culture LGBT+.
Cet épisode est symptomatique de la guerre culturelle qui fait rage aux États-Unis. Depuis plusieurs années, des élu·es conservateur·ices et des parents d’élèves demandent ou orchestrent l’interdiction d’ouvrages dans les écoles sous prétexte qu’ils seraient « choquants » pour les élèves. Sont principalement visés les ouvrages portant sur la sexualité, le genre, les transidentités et la question raciale. Selon l’association Pen America, plus de 10 000 livres auraient été interdits – au moins temporairement – dans les écoles publiques au cours de l’année scolaire 2023–2024. Parmi les titres les plus fréquemment ciblés, on trouve Dix-neuf minutes, de Jodi Picoult, L’Œil le plus bleu, de Toni Morrison, La Servante écarlate, de Margaret Atwood, ou encore Gender Queer, de Maia Kobabe.
Les interdictions de livres sont des éléments de la guerre culturelle, particulièrement brutale à l’égard des personnes trans, contre ce que les réactionnaires appellent « le wokisme ». D’après vous, qu’est-ce qui explique cette panique morale ? Comment devrions-nous y répondre ?
Jamais les Républicains n’auraient pu anticiper la popularité des mouvements trans de ces dernières années. Ces mouvements sont non seulement une menace pour leur pouvoir, mais aussi le symbole de tout ce qui les effraie. La binarité de genre est tenue pour évidente depuis si longtemps. Sa remise en question représente la possibilité de questionner de nombreux facteurs qui ont établi la suprématie blanche, le patriarcat hétérosexuel et tant d’autres phénomènes oppressifs.
Le mouvement trans est une révolution politique, économique et idéologique qui va bien au-delà de la question du genre. Il est aussi important de reconnaître que la compréhension de la notion de genre par tant de gens dans un laps de temps relativement court est un phénomène révolutionnaire. Si nous devons nous opposer au mouvement fasciste, c’est aussi parce qu’il considère comme des ennemi·es celles et ceux qui ne se conforment pas aux normes de genre.

Votre militantisme a‑t-il évolué sur les questions LGBT+ ? Le fait d’être lesbienne 6 Angela Davis a fait son coming out en tant que lesbienne dans le magazine Out en 1997. joue-t-il un rôle dans votre façon de penser, dans votre façon de militer aujourd’hui ?
Je m’efforce de me tenir à distance des présupposés identitaires selon lesquels on serait davantage susceptible de s’engager dans la lutte si l’on est membre d’un groupe dont la liberté est remise en question. Je soutenais la cause LGBT+ bien avant que les transformations de ma vie personnelle ne m’amènent à m’identifier comme membre de la communauté queer.
Il faut savoir que l’une des caractéristiques du Black Panther Party était non seulement son soutien aux luttes de libération dans le monde entier, en tant que parti internationaliste, mais aussi à ce que l’on appelait alors le mouvement de libération gay (7). Et c’était à la fin des années 1960 !
En tant que militante révolutionnaire et radicale, j’étais très opposée au fait de se focaliser sur le mariage pour les personnes de même sexe : la communauté queer a été une force de contestation du mariage comme institution capitaliste. J’étais aussi opposée à l’inclusion des personnes LGBT+ dans l’armée.
Pour moi, la question n’est pas de réclamer l’inclusion, mais de se mobiliser collectivement pour faire tomber l’armée. Dans le mouvement noir également, il faut faire attention aux logiques assimilationnistes. Elles semblent parfois prendre le dessus et empêcher les éléments les plus radicaux, révolutionnaires et libérateurs de cette lutte de parvenir à une place centrale.
Angela Davis, du communisme au féminisme des marges
Née en 1944, au temps de la ségrégation raciale dans le sud des États-Unis, Angela Davis dit avoir grandi dans un contexte qui ne lui « a pas laissé d’autre choix que d’être une activiste ». Sous l’influence de l’engagement antiraciste et communiste de sa mère, Sallye Davis, elle forge très jeune sa conscience politique.
C’est d’ailleurs la passion de sa mère pour la chanteuse Billie Holliday qui amènera plus tard Angela Davis à écrire une analyse féministe du blues, dont les interprètes dénoncent dès le début du xxe siècle les violences sexistes et racistes (Blues et féminisme noir, Libertalia, 2017).
Étudiante engagée dans des mouvements noirs des années 1960, elle y découvre une culture patriarcale qui la révolte. Membre du Parti communiste, elle rejoint le Black Panther Party, un mouvement révolutionnaire de libération africain-américain, en 1968. Surveillée par le FBI, elle est accusée à tort de meurtre et risque la peine capitale. Elle est arrêtée en 1970 après une longue cavale. Son incarcération pendant seize mois forge son engagement pour l’abolition du système carcéral.
Elle dénonce en particulier la violence singulière qui s’y déploie contre les femmes, notamment enceintes, mères et non blanches. Avec des soutiens dans le monde entier, elle devient une icône de la lutte féministe et antiraciste.
En 1972, sa rencontre avec Toni Morrison – alors éditrice, elle la convainc de publier son autobiographie – sera déterminante tant sur le plan amical qu’intellectuel. Une autre rencontre a marqué son parcours de féministe, celle de Gerty Archimède, première femme avocate des Antilles françaises, communiste et féministe, qu’elle rencontre en Guadeloupe en 1969.
En 1981, Angela Davis publie Femmes, race et classe, ouvrage majeur qui s’inscrit dans la longue tradition d’un féminisme des marges et pose les jalons d’une pensée exigeante enjoignant au féminisme de tenir compte des luttes antiracistes, des mouvements ouvriers et des droits reproductifs pour tous·tes.
Vous êtes depuis longtemps engagée en faveur de la Palestine. Avec le génocide en cours à Gaza, le soutien au peuple palestinien est-il devenu prioritaire pour vous ?
Nous sommes nombreux et nombreuses à nous préoccuper de ce qui se passe actuellement à Gaza et au Liban. Mais nous ne prétendons pas qu’il s’agit de la lutte la plus importante au monde. Je me suis toujours méfiée du processus de hiérarchisation entre les causes. Je crois plutôt à leur interdépendance. Ce qui se passe à Gaza dépasse Gaza.
Tout comme nous avons considéré la lutte contre l’apartheid sud-africain non pas comme la plus importante des luttes contre le racisme, mais comme une lutte qui aurait des répercussions dans le monde entier. Personne ne peut être sur tous les fronts mais on peut être conscient·es des relations entre les luttes.
C’est ainsi que nous créons une sorte de connexion dans le monde. Mais nous ne devons pas dire qu’il est plus important en ce moment de soutenir le mouvement palestinien que de soutenir, par exemple, les Haïtiens et les Haïtiennes, qui souffrent terriblement à cause de la position historique du gouvernement français (8).
Nous vivons à une époque où les actes des ultrariches concourent à l’accélération de l’extinction planétaire. Comme à Gaza, où la production capitaliste d’armes, aux mains de quelques entreprises, ne détruit pas seulement les maisons, les mosquées et les hôpitaux, mais aussi la possibilité même de vivre. Nous sommes face à un génocide, comme le rappellent les accusations portées par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice.
« Je me tiens à distance des présupposés identitaires selon lesquels on serait davantage susceptible de s’engager dans la lutte si l’on est membre d’un groupe dont la liberté est remise en question. »
Vos engagements englobent la préservation du vivant et de l’écologie en général, pourriez-vous nous en parler ?
Le changement climatique est profondément lié aux luttes contre le racisme et contre le capitalisme. Bien sûr, le capitalisme est responsable des terribles dégâts infligés à la planète. La justice environnementale est le point de départ de la justice sociale. Si nous remportons des victoires dans nos luttes contre le racisme, la misogynie, l’homophobie, etc., mais que la planète est détruite, alors ces luttes n’ont plus aucun sens. Nous devons donc tous et toutes concevoir la protection de la planète comme une urgence absolue.
Je pense que les populations du Sud global devraient être en première ligne de ces luttes. La prédation des entreprises capitalistes – par exemple dans l’agriculture – a pour effet de détruire les cultures autochtones, qui savaient protéger la terre. Or ces cultures comprenaient l’importance des approches durables dans l’agriculture et la nécessité de préserver la biodiversité.
À titre personnel, je suis végane, pour minimiser mon impact sur la planète, mais je n’impose pas ma manière de vivre. Je pense simplement que nous devrions être conscient·es de nos activités quotidiennes et de l’impact qu’elles ont sur des êtres vivants, bien au-delà de la portée de nos vies.
Vous avez passé beaucoup de temps en France. Qu’en avez-vous retiré ?)
Ma mère avait l’habitude de dire, lorsque j’étais petite, que je devais toujours porter mon imagination au-delà de l’endroit où je me trouvais. Mes études en France ont joué un rôle très important dans ce processus, et je ne l’oublierai jamais. Même si aujourd’hui je sais combien la France a tendance à se présenter comme la plus grande adversaire du racisme dans le monde sans voir les actes racistes qui se produisent sur son sol. Je pense que la France fait face à une crise d’identité. Le colonialisme a été au cœur de son développement et de celui de tous les pays occidentaux, mais heureusement les descendant·es de ces histoires bousculent cette position et s’impliquent dans la création d’une France très différente. •
Entretien réalisé en anglais, en visioconférence le 14 novembre 2024.
Angela Davis en 7 dates
1944
Naissance d’Angela Davis à Birmingham (Alabama), un des États les plus ségrégués des États-Unis
1962
Elle entame des études de littérature française et de philosophie à l’université Brandeis (Massachusetts). Elle étudie plusieurs moi à la Sorbonne à Paris, et deux ans à Francfort.
1970
Accusée de meurtre, elle figure parmi les dix personnes les plus recherchées par le FBI. Menacée de la peine capitale, elle fait l’objet d’une campagne de soutien internationale.
1972
Emprisonnée pendant seize mois, elle est acquittée à l’issue de son procès
1981
Publication de son livre Femmes, race et classe, une série de 13 essais qui propose avant l’heure une approche intersectionnelle des rapports de pouvoir.
1991
Elle est nommée professeure, puis directrice du département d’études féministes de l’université de Californie à Santa Cruz, fonction qu’elle occupe jusqu’en 2021.
1999
Publication aux États-Unis de son ouvrage Blues et féminisme noir, une histoire politique et féministe de la musique noire des années 1920–1940.