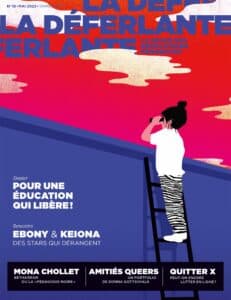Le comportement humiliant de Donald Trump à l’égard du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, le 28 février à la Maison Blanche, a été beaucoup commenté. Quel regard féministe peut-on poser sur cette scène ?
Nous assistons à une véritable démonstration viriliste de chefs d’État qui semblent dire qu’on ne peut exister sur la scène internationale qu’en tant que dominant ou dominé. Alors qu’ils sont la base de la diplomatie, le dialogue, la raison, le compromis ou le développement de relations fondées sur le respect sont perçus comme des comportements faibles et associés au féminin. C’est un type de diplomatie qu’on peut qualifier d’antiféministe. Au sujet du rapprochement entre Donald Trump et Vladimir Poutine, certains commentateurs parlent de « diplomatie des bros » [pour brothers, « frères »], d’un boys club organisé en meute sur la scène internationale, pour qui le monde est un terrain de jeu. Pour Trump comme pour d’autres dirigeants, adopter ce comportement revient à montrer patte blanche à Poutine et à s’aligner sur sa stratégie brutale, notamment lorsqu’il s’agit des droits des personnes LGBTQIA+.
Justement, peut-on revenir sur ce qu’est la diplomatie féministe ?
La diplomatie féministe consiste à intégrer une perspective de genre dans la politique étrangère d’un pays. Elle s’appuie sur une politique de coopération internationale, notamment par une aide publique au développement qui prend en compte les besoins et les expériences spécifiques des femmes. Cette approche implique de considérer les enjeux d’égalité de genre comme transversaux dans les politiques qui sont menées – défense des droits sexuels et reproductifs, lutte contre les violences basées sur le genre, réduction des inégalités, paix et sécurité humaine…
Pour être efficace, la diplomatie féministe doit travailler avec des ONG féministes et avec la population civile. À l’Institut du Genre en Géopolitique (IGG), nous considérons qu’elle doit être intersectionnelle et décoloniale pour transformer les structures de pouvoir existantes. Mais également antifasciste.
En février 2025, le président argentin, Javier Milei, a symboliquement offert une tronçonneuse à Elon Musk. Nous avons assisté aux saluts nazis répétés de ce dernier mais aussi de l’ancien conseiller de Donald Trump Steve Bannon. Parallèlement, l’administration Trump est en train de démanteler l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Concrètement, comment la diplomatie féministe peut-elle se positionner dans ce contexte ?
Les multiples crises économiques, politiques, sanitaires et environnementales affectent les femmes de manière disproportionnée : 80 % des personnes déplacées à cause du changement climatique sont des femmes ; elles ont 14 fois plus de risque de mourir lors d’une catastrophe naturelle. La diplomatie féministe a un rôle central à jouer pour les défendre.
Par ailleurs, lors de son investiture, le président Trump a repris la formule « Drill, baby, drill ! » (« Fore, bébé, fore ! »), qui encourage l’extractivisme et renvoie métaphoriquement à un acte de pénétration. Car l’exploitation de la terre va de pair avec l’exploitation des femmes. Mais il faut garder espoir : la diplomatie féministe structure ses efforts à travers des initiatives comme le Groupe de politique étrangère féministe (FFP+) de l’ONU, qui travaille en collaboration avec la société civile, où les mouvements féministes se développent considérablement. Le rôle de la diplomatie féministe est de défendre les droits humains et les libertés individuelles. Tout ce que le fascisme déteste.
« En affirmant sa puissance militaire tout en prônant une diplomatie féministe, la France envoie un message contradictoire. »
La France se présente souvent comme pionnière en matière de diplomatie féministe, tout en coopérant avec des partenaires commerciaux qui bafouent les droits des femmes, comme l’Arabie saoudite ou Israël. N’y a‑t-il pas un risque que la diplomatie féministe soit uniquement une vitrine marketing ?
Effectivement, de nombreux pays revendiquant une diplomatie féministe restent guidés par des intérêts géopolitiques et économiques qui desservent les droits des femmes. La France est le deuxième exportateur d’armes au monde. Une activité qui contribue directement aux violences subies par les femmes et les minorités dans certaines régions du monde. En affirmant sa puissance militaire tout en prônant une diplomatie féministe, la France envoie un message contradictoire.
À Gaza, les Palestiniennes sont victimes du silence complice des puissances occidentales [selon l’ONU, les femmes et les enfants représentent près de 70 % des victimes des bombardements israéliens]. Le revirement du président Macron sur l’arrêt des ventes d’armes à Israël en octobre 2024 est arrivé trop tard, et le soutien à Israël reste majoritaire. Cet immobilisme s’explique, en France, par un contexte de forte instrumentalisation de l’antisémitisme, d’extrême-droitisation du champ politique et d’un traitement ultra émotionnel de ces thématiques depuis le 7 octobre 2023.
Le gouvernement oppose un prétendu réalisme stratégique à un pacifisme féministe inapplicable dans le réel. Cela illustre une vision du monde où la realpolitik et la politique du « deux poids, deux mesures » prédomine. Récemment, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a publié une brochure afin de définir la diplomatie féministe de la France pour 2025–2030 : elle comporte seulement huit pages et propose des objectifs flous, sans plan d’action.
Malgré tout, dans un contexte international où les droits des femmes sont de plus en plus menacés, il reste crucial que certains États défendent, même très imparfaitement, ces principes, car cela crée un effet d’entraînement entre les pays.