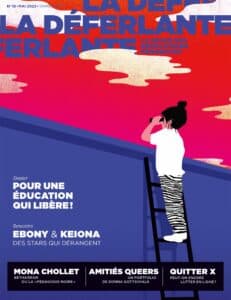Dans la région, c’est une périphérie de ville comme une autre, jalonnée de pavillons néobretons qui se suivent. Mais dès l’entrée dans l’agglomération quimpéroise, en contrebas des premières maisons, se révèle un géant de tôles grises.
Quand on s’en approche, une odeur caractéristique imprègne l’atmosphère : celle du maquereau grillé, la spécialité de cette usine du groupe Saupiquet. « Elle reste tellement marquée qu’à la maison, je range tous mes vêtements de travail lavés dans une boîte en plastique, décrit de sa voix rocailleuse Rachel*. Le 20 décembre, j’ai prévu de tous les brûler. »
Quand nous la rencontrons début novembre 2024, la quinquagénaire, qui a trimé douze ans à la conserverie quimpéroise en tant qu’opératrice de production, puis comme chargée des sauces, appréhende l’échéance à venir. « Jusqu’ici, j’étais un peu dans le déni », avoue-t-elle en soupirant. Car la direction a annoncé avant l’été que l’entreprise, qui employait 151 salarié·es et 70 intérimaires, fermerait le 20 décembre pour délocaliser ses ateliers en Espagne et au Maroc. La faute aux coûts de production devenus trop élevés, selon la direction financière. Ce départ signe la fin d’une aventure industrielle : le site de Quimper était le dernier de la marque Saupiquet encore présent en France.

Si Saupiquet appartient depuis 2000 à la multinationale Bolton Food, l’entreprise a, depuis sa naissance à Nantes en 1891, longtemps campé le rôle de fleuron français dans le secteur de l’agroalimentaire. Pont‑l’Abbé (Finistère), Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée), Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques)… elle avait de nombreux ateliers de conserves de poissons et de légumes dans tout le pays. Mais ils ont fermé les uns après les autres, malgré les mobilisations s’opposant à leur disparition.
En 1989, par exemple, les salarié·es faisaient grève pour éviter un plan social massif. Ils et elles ont à nouveau débrayé au moment du rachat par Bolton, ainsi qu’en 2010 à l’annonce de la fermeture du site de Saint-Avé (Morbihan). En tête des manifestations, bien souvent, des femmes. Aujourd’hui encore, elles représentent 76 % des effectifs chargés de la production des conserves de Saupiquet à Quimper, contre 35 % seulement à la logistique et à la maintenance (1).
Devant la manufacture, par un lumineux après-midi d’automne, Rachel, son confrère ingénieur en recherche et développement Guillaume, et la conductrice de ligne (2) Valérie Bonder font part de leur accablement. « Nous avions un plan de production jusqu’en 2027, avec des objectifs chiffrés, donc nous ne pouvions pas imaginer un tel scénario », assure cette dernière, déléguée syndicale CFDT de 57 ans. Son collègue trentenaire ne cache pas sa colère : « Les filles ont fait des efforts et la façon dont on les remercie, c’est de fermer l’usine ! »
« Il m’est arrivé de dormir les deux mains dans l’eau tellement elles me brûlaient. »
Agnès Gloaguen, ancienne ouvrière chez Saupiquet
« Les filles » : c’est ainsi que les ouvrières se nomment entre elles et ainsi qu’on les présente en retour. « Il y a un côté très paternaliste, infériorisant à les appeler de cette manière. En même temps, cela peut créer une sorte de popularité : ce sont “nos” filles qui sont victimes de licenciement ou qui subissent de mauvaises conditions de travail. Il s’agit alors de les protéger », remarque Fanny Gallot, historienne spécialiste des mobilisations de travailleuses, contactée quelques jours plus tard.
Chez Saupiquet, il y a « les filles » au parage, à l’emboîtage, au sertissage (3), toutes ces étapes clés dans la fabrication d’une conserve de poisson. Sur le site de Quimper, on transforme le maquereau et les sardines ; on travaille également les poissons destinés à de gros boîtages pour la restauration collective.
Les conserveries de l’ouest de la France ont presque toujours dévolu ces métiers physiques, mal rémunérés et répétitifs aux femmes. Au XIXe siècle, c’étaient déjà elles qui, au retour des bateaux sur lesquels avaient œuvré leurs maris, mitonnaient le fruit de la pêche et le mettaient en boîte dans les centaines d’ateliers de la région.
Cette répartition genrée s’est figée dans le temps. « On dit aux ouvrières que leurs gestes de préparation du poisson sont plus efficaces que ceux des hommes », explique Valérie Bonder, alors qu’à ses côtés Rachel mime de ses petites mains celui consistant à s’emparer d’une sardine et à la découper en quelques secondes.
Un argument qu’on retrouve dans tous les secteurs professionnels, selon l’historienne Fanny Gallot, qui souligne un phénomène de « naturalisation des compétences » : « On assigne les femmes à des emplois peu qualifiés parce qu’elles seraient adaptées aux “tâches répétitives et simples”, selon le terme employé en 1971 par le CNPF, l’ancêtre du Medef (4). Il n’y a évidemment rien de naturel dans tout cela. La dextérité, comme les autres aptitudes, est un apprentissage. »
« Ce qui est étonnant, c’est que la plupart des femmes s’approprient ce discours », relève pour sa part Tiphaine Guéret, autrice d’Écoutez gronder leur colère. Les héritières des Penn sardin de Douarnenez (Libertalia, 2024), une enquête réalisée auprès des ouvrières actuelles de conserveries de Douarnenez, à une vingtaine de kilomètres de Quimper. D’anciennes employées de Saupiquet évoquent ainsi tour à tour leur délicatesse, leur minutie, leur propreté pour expliquer la division sexuée du travail. « Les hommes à l’emboîtage ? Ce serait trop répétitif pour eux », estime Mathilde Tomporski, qui a turbiné sept ans chez Saupiquet.
La révolte méconnue des sardinières bigoudènes
La grève victorieuse des sardinières de Douarnenez durant l’hiver 1924 a occulté, dans la mémoire collective, celle des ouvrières du pays Bigouden, au sud-ouest de Quimper, entre 1926 et 1927.
Des milliers d’entre elles bloquent alors les ateliers pour obtenir elles aussi un salaire plus élevé. L’historienne Fanny Bugnon, qui dans L’Élection interdite. Itinéraire de Joséphine Pencalet, ouvrière bretonne (1886–1972) (Seuil, 2024) retrace le destin politique de Joséphine Pencalet, sardinière à Douarnenez, fait ressortir un contraste entre les deux grèves : « Douarnenez va devenir une vitrine pour les luttes ouvrières et le mouvement communiste ; les Bigoudènes, elles, n’ont pas été autant médiatisées et soutenues politiquement. »
Le patronat lance une répression féroce à leur égard, n’hésitant pas à affamer ouvrières et marins-pêcheurs. Les anciennes ont préféré taire cette période très dure : « Elles ne pouvaient pas dire avec des mots ce qui s’était passé », souligne Marie-Aline Lagadic, qui a tenté d’interroger des femmes de sa famille ayant connu la grève, sans succès.
Une image de cette mobilisation est néanmoins parvenue jusqu’à nous : la toile de Charles Tillon La Révolte des sardinières. La scène se déroule sur une dune, à Lesconil, à l’extrémité sud du pays Bigouden. Des femmes en coiffe mènent le cortège, drapeau rouge dans les airs, des marins en vareuse dans leur sillage. Ce tableau est parfois utilisé, à tort, pour illustrer la révolte de Douarnenez, ville située hors du pays Bigouden à une quarantaine de kilomètres plus au nord.
Des cadences qui abîment le corps
Celle qui a effectué une grande partie de sa vie professionnelle dans l’agroalimentaire exerçait ce métier pour « payer [s]es factures et nourrir [s]a famille », mais elle a dû quitter l’entreprise en 2018. « C’était soit ça, soit je perdais mon épaule », explique l’ex-conductrice de ligne qui enchaînait tendinites et séances de kiné.
Car dans l’enceinte de l’usine, on travaille debout, en 2/8 (5). Deux pauses chronométrées viennent ponctuer chaque journée, une de 13 minutes et une de 23 minutes. Les sardines et les maquereaux s’écoulent sans discontinuer sur les tapis qui défilent, charriant jusqu’à 10 tonnes par ligne. Les ouvrières travaillent en binôme la plupart du temps. « En moyenne, par minute, les pareuses nettoient 10 poissons et les emboîteuses en mettent 12 en conserve », chiffre Valérie Bonder. Elle supervise de son côté une équipe de trente à quarante ouvrières en veillant au respect des consignes d’hygiène et de sécurité. L’ancienne gérante de discothèque, arrivée en 2010, a compté : elle parcourt plus de 20 000 pas au quotidien.
Dans le brouhaha assourdissant des machines, les gestes – toujours les mêmes – sont effectués à une cadence infernale. « À force de les répéter, cela crée presque un manque » quand on cesse de les pratiquer, remarque Agnès Gloaguen, 68 ans aujourd’hui. Nous l’avons rencontrée via les réseaux sociaux et les posts dans lesquels elle évoquait avec nostalgie son passé à l’usine. Cette native de Pont‑l’Abbé a, comme sa mère et sa grand-mère avant elle, rejoint la conserverie.
C’était en 1972, elle n’avait que 16 ans. Pendant sept ans, elle a nettoyé ou mis en boîte le poisson avec une binôme. Elle se souvient de la ferraille qui coupait ses doigts et du feu au contact des piments : « Il m’est arrivé de dormir les deux mains dans l’eau tellement elles me brûlaient. »
Ces conditions de travail particulièrement âpres expliquent les répercussions physiques récurrentes chez les salarié·es. « J’ai de l’arthrose sur tout le côté gauche de mon corps », raconte Claudine Le Cam, 66 ans, dont 39 – toute sa carrière – passés chez Saupiquet en tant qu’ouvrière polyvalente. Dans une analyse portant sur l’année 2018, la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Bretagne soulignait la responsabilité de l’industrie agroalimentaire locale dans la survenue des maladies professionnelles, et notamment des troubles musculosquelettiques (6). Claudine, désormais retraitée avec quatre médailles du travail au compteur, se remémore comment on tentait d’oublier la dureté de la tâche : « À mes débuts dans les années 1980, il nous arrivait de chanter, tellement c’était convivial et familial entre nous. »
Des chansons pour mémoire
Durant des décennies, les ouvrières ont entonné des mélodies en chœur au sein des ateliers quimpérois, comme partout ailleurs dans les conserveries bretonnes. Puis la musique s’en est allée. Même les conversations ont disparu pendant la période covid. Rachel se rappelle des parois en plexiglas qui séparaient les ouvrières sur les lignes, et des masques : « Alors qu’avant on arrivait à se parler en lisant sur les lèvres, d’un coup on passait la journée toute seule, sans discuter avec personne. Vous imaginez ? »
Mais au-delà du contexte sanitaire des années 2020, « aujourd’hui, les usines ne sont plus faites pour chanter », remarque Klervi Rivière. La bretonnante a recueilli avec sa mère Marie-Aline Lagadic des chansons regroupées sur un CD intitulé Les Chants des sardinières. Elles ont ensuite interprété en concert ce matrimoine découvert notamment par leurs aïeules, ouvrières de conserverie qui répétaient les chants en famille.

Toutes les deux ont besogné chez Saupiquet : Klervi à Quimper comme conductrice de ligne et Marie-Aline sur l’ancien site de Pont‑l’Abbé, où elle découpait et mettait le poisson en boîte. « L’association de collectage Dastum cherchait des chants patrimoniaux bretons. Je leur avais dit : “Il faut aller dans les conserveries, c’est incroyable ce que les femmes nous ont laissé” », se remémore Marie-Aline, qui avait incité les salariées les plus âgées à dévoiler leur répertoire musical au travail.
C’est une partie de celui-ci qui résonne dans la salle des fêtes de Douarnenez : dans une ambiance chaleureuse, Manon Hamard, enthousiaste cheffe de chœur au béret rouge, fait répéter une foule de plus de 300 personnes, retraité·es, parents et jeunes enfants réuni·es pour commémorer, entre novembre 2024 et janvier 2025, le centenaire de la grève des sardinières.
Portée par deux collectifs locaux, cette grande fête avec concerts, expositions et conférences souhaite rendre hommage aux 2 000 sardinières qui se sont mobilisées avec succès pour de meilleurs salaires entre 1924 et 1925. Dans la ville, ce mouvement social est devenu un objet mémoriel à partir des années 1980, « notamment à l’initiative de femmes qui ont voulu transmettre l’histoire de leur famille, mais aussi de la municipalité communiste de l’époque », explique Camille Courgeon, doctorant·e en histoire dont le mémoire de master portait sur cette question.
Pour Sarah et Val (elles n’ont pas souhaité donner leur nom de famille), bénévoles : « C’est un héritage à diffuser. » Elles reconnaissent toutefois la difficulté de mobiliser les ouvrières des conserveries d’aujourd’hui dans ce rassemblement : « Cela nécessite un travail de fond, car il y a des cassures dans la société. »

Un savoir-faire délocalisable ?
L’écho de ce combat centenaire ne s’est pas fait entendre jusqu’à l’usine Saupiquet de Quimper lorsque la direction a annoncé l’arrêt planifié de son activité. Contrairement aux anniversaires des décennies précédentes, ni cortèges ni manifestations ne sont organisées. « L’important pour nous était de négocier en bonne intelligence, notamment sur le montant des indemnités de départ », explique la déléguée syndicale Valérie Bonder. Mais, comme Rachel et Guillaume à ses côtés, elle n’a aucune idée d’où elle travaillera ensuite.
La résignation l’a emporté et a creusé des fossés entre salarié·es, laissant l’amertume s’emparer de celles et ceux qui « n’arrivent pas à digérer la situation », constatent les trois travailleur·euses. Seules les anciennes, toujours fières d’avoir œuvré à la machine réputée pour sa qualité, ont envoyé du soutien à leurs ex-collègues. « On a changé quatre fois de patron, on a relevé des grèves avec les syndicats, on a donné de notre personne pour cette usine », s’attriste Claudine Le Cam. « C’est un pan de l’économie qui s’effondre, un morceau de l’histoire de la Cornaille qui s’en va », déplore la chanteuse Klervi Rivière.
Ces ouvrières dont le savoir-faire dans le travail du poisson a toujours été reconnu découvrent que leurs compétences sont délocalisables… quand bien même les ateliers espagnols et marocains ne sont pour le moment pas capables de les reproduire. Ironie du sort, elles doivent mettre les bouchées doubles pour préparer de quoi continuer à alimenter le marché entre la fermeture de leur usine et la mise en service des lignes de production espagnoles et marocaines. « On n’a jamais eu de tels stocks de boîtes de maquereau à la moutarde », raille Rachel. Une chose est sûre, même loin de l’usine, loin des conserves et loin du poisson, elle emportera le souvenir d’une odeur : « C’est quelque chose que l’on n’oublie pas. » •
Reportage réalisé les 7 et 19 novembre 2024, à Quimper et Douarnenez (Finistère).
* Ces personnes ne souhaitent pas que leur nom de famille soit mentionné.
(1) Source syndicale.
(2) Ce poste consiste à superviser les salarié·es œuvrant sur une même ligne de production.
(3) Le parage consiste à débarrasser le poisson de ses parties les moins nobles. Le sertissage consiste à fermer les boîtes de façon hermétique.
(4) Le Problème des O.S. Rapport du groupe d’étude patronal, Éditions du CNPF, 1971.
(5) . Deux équipes tournent sur un même poste par roulement de huit heures l’une et l’autre, assurant ainsi la production pendant seize heures au total.
(6) « Les accidents du travail et maladies professionnelles en Bretagne en 2018 », juillet 2022. Consultable en ligne sur le site de la Dreets.