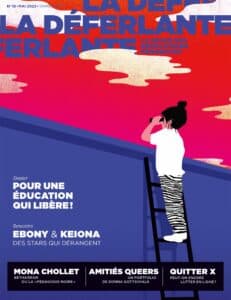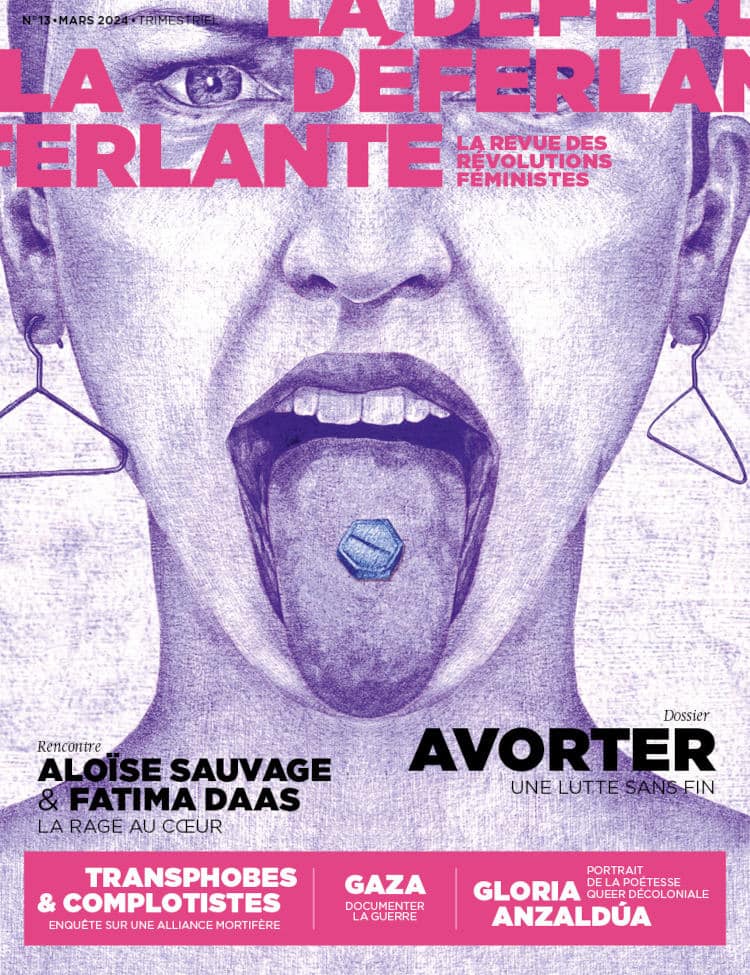« Il y a de fortes chances pour que je meure un jour de ma relation. Mon nom ne sera pas sur les murs, je ne serai pas dans les décomptes des féminicides : même dans la mort, je n’existerai pas. » Voilà ce que se répétait sans cesse Sophie à l’époque où elle était mariée.
Une rencontre, un mariage, un enfant, puis, près de dix ans plus tard, un divorce et une condamnation de son ex-compagne pour violences conjugales. Une histoire d’amour qui n’en était pas une.
Comme Sophie, amantes, amies, conjointes, épouses, mères, lesbiennes ou bisexuelles ont subi ou endurent encore des violences dans leurs relations intimes avec d’autres femmes (1) – elles aussi des amantes, amies, épouses, lesbiennes ou bies… mais également des agresseuses. « C’était quelqu’un qui ne supportait pas que je dise non », se souvient de son côté l’artiste et illustratrice Rizzo Boring. Celle qui se revendique « militante gouine et handie » témoigne en son nom pour la première fois, sept ans après la fin d’une relation qui a duré six mois. « À chaque fois qu’on se voyait, il y avait des moments de violence, de crise et de tension. Elle me dénigrait et m’humiliait. Elle me disait que j’étais bête, pas digne de confiance ni apte à faire mes choix. À la longue, on finit par y croire. » Et comme le raconte Sophie, qui tient le compte Instagram « Violences en milieu queer », on se retrouve au bout d’un moment isolée de ses proches : « Étant donné la violence que cela provoquait chez mon ex-compagne, je préférais renoncer à voir mes ami·es, cela ne valait pas le coup. »
Mettre à distance la norme hétéro
Certains points communs existent avec les violences commises dans un contexte hétéro : l’isolement d’avec l’entourage ou le dénigrement perpétuel, par exemple. Mais les violences au sein des couples lesbiens ne sont pas le miroir de celles qui éclatent dans les couples hétéros. Comme l’explique la sociologue et démographe Tania Lejbowicz, dans des couples de même genre, lorsque les femmes déclarent des violences, elles « rapportent plus d’actes psychologiques, mais moins de violences physiques et encore moins de violences sexuelles » que les femmes qui déclarent des violences dans les couples de sexe opposé. Pas besoin de dimension physique pour que la violence existe : en sciences sociales, « on parle même de terrorisme conjugal lorsque est exercé un contrôle continu accompagné de dénigrement, qui place la victime dans une situation d’angoisse permanente ». Une forme de coercition observée en milieu lesbien, même si elle est plus rare que dans les couples hétéros. Tania Lejbowicz, qui a travaillé sur le volet LGBT de l’enquête Violences et rapports de genre (dite « Virage ») de l’Institut national d’études démographiques (Ined), rappelle qu’en mettant à distance la norme hétérosexuelle, les lesbiennes et les bies peuvent adopter une lecture différente de la violence et de la sexualité : « On le voit en prenant un contexte égal, le cadre du couple hétéro. Les lesbiennes qui ont eu des relations avec des hommes cisgenres et les personnes bisexuelles déclarent plus qu’elles ont subi des violences sexuelles de la part d’un ex-conjoint violent, et les hétérosexuelles déclarent beaucoup plus avoir subi des violences physiques. »
Certaines violences cependant sont spécifiques aux personnes queer, comme le fait de ne pas être genré·e correctement – le mégenrage –, ou la menace de voir révélée à son insu son identité de genre ou son orientation sexuelle dans un espace où l’on est encore dans le placard, une pratique appelée outing. L’assignation sociale des femmes au care, c’est-à-dire au fait de prendre soin des autres, n’empêche pas que la santé aussi devienne un levier de contrôle. Durant la période où elle vivait une relation violente, la pathologie dont souffre Rizzo Boring n’avait pas encore été diagnostiquée, et elle se trouvait en situation d’errance médicale. Son ex-compagne « était persuadée de savoir quel était le bon traitement ou le bon médecin pour moi, et cela m’a mise en danger. Comme elle était une de mes seules ressources au quotidien, je pensais ne pouvoir compter que sur elle si la maladie empirait. »
Mais le contexte spécifique lesbien n’est pas forcément gage d’une prise de conscience accrue. « Le fait d’être lesbienne a beaucoup brouillé les pistes, souligne Sophie. On parle de quelqu’un qui me mettait des coups de poing et de pied, qui a voulu m’étrangler à plusieurs reprises : si, dès les prémisses, j’avais vécu les mêmes choses avec un mec cisgenre, je ne serais pas allée aussi loin. » Avant d’être elle-même victime de violences, Rizzo Boring avait, de son côté, déjà accompagné des femmes violentées au sein d’une association. Connaissant très bien les mécanismes de l’emprise, elle pensait être à l’abri. « Même moi, j’ai cru que c’était moins grave parce que cela venait d’une femme. C’est important de rappeler qu’être féministe ne nous protège pas. » Et l’entourage, aussi averti soit-il, peut être aveugle aux signes qui affleurent. « Un jour où j’étais en short avec les cuisses couvertes de bleus, un ami m’a demandé en rigolant si on avait des pratiques sadomasochistes, se souvient Sophie. Peut-être qu’il aurait été plus à l’affût si j’avais été avec un homme. » À l’affût, les personnes queer le sont, mais elles ne sont pas socialisées pour repérer la violence au sein de leur propre communauté : « Je me disais : “L’ennemi, c’est l’homophobe, pas la personne que je crois aimer” ». Elle qui s’est mariée dès 2013, juste après la loi sur le mariage pour tous et toutes, se souvient des « monceaux d’insultes » reçus durant cette séquence médiatico-politique : « J’en pleurais. Pour moi, la violence était là. Alors, se dire que cela pouvait venir de tous les côtés, c’était trop. »
Les limites de la solidarité communautaire
Selon Nabintou Mendy, chargée, au sein de l’association En avant toute(s), d’une permanence d’accompagnement social et psychologique pour les personnes LGBT+ victimes de violences conjugales, parler peut être vécu comme une forme d’échec personnel pour les personnes lesbiennes et bies qui, en relationnant avec d’autres femmes, ont cru échapper à une forme de violence typique du cadre hétérosexuel. Pour elle, le slogan « Le féminisme, c’est la théorie, le lesbianisme, c’est la pratique », qui fleurit de nouveau sur les pancartes des manifestations ces dernières années, peut renforcer l’idée qu’une sortie de l’hétérosexualité protège. Or, « nous vivons dans une société patriarcale où la violence est omniprésente. Peu importe notre genre ou notre orientation sexuelle, on peut reproduire cette violence dans le cercle intime. »
Un matériau prisé par les masculinistes
Dans ce contexte, parler, c’est parfois se heurter à des formes de minimisation, de déni ou de rejet de la part d’autres personnes LGBT+. C’est ce qui a décidé Lucie à lancer avec une amie, en 2022, le hashtag #MeTooLesbien, devenu depuis une plateforme de témoignages : « Je n’ai reçu quasiment aucun soutien au moment où je vivais des violences dans mes relations. Et même des années plus tard, c’est toujours difficile d’en parler librement. On a parfois intériorisé le gaslighting (2) de nos agresseurs et agresseuses, ou même celui de la communauté LGBT, on se dit qu’il y a des combats plus importants à mener, que d’autres ont vécu bien pire. On peut également culpabiliser de dénoncer des personnes qui ont elles aussi été victimes de violences et d’injustice. » Car un groupe structuré par l’expérience du vécu minoritaire – qu’il soit féminin, lesbien, queer ou trans – peut mettre en place des mécanismes d’autodéfense communautaire, dans lesquels la cohésion du collectif se fait au détriment de certains de ses membres. Si bien que la libération de la parole est parfois plus facile auprès de féministes hétéros, témoigne Rizzo Boring : « Elles n’avaient pas le souci de la sororité lesbienne, et pour elles, ce que je vivais était très clair. »
Dès lors, témoigner de violences conjugales entre femmes, est-ce desservir la cause LGBT+ ? Certaines préfèrent ne pas prendre ce risque, et évitent d’évoquer ces violences lorsqu’elles s’adressent à un public peu sensibilisé aux luttes féministes. La sociologue Vanessa Watremez se souvient avoir décliné de nombreuses interviews, notamment pour la télévision : « Il y avait beaucoup de lesbophobie et d’homophobie dans les médias après le passage du pacs en 1999. Alors, dire que les lesbiennes étaient violentes dans leurs relations, c’était en rajouter une couche. Je craignais que cela soit mal compris. » Mal compris, ou clairement instrumentalisé. Les masculinistes font feu de tout bois : tantôt ils se servent des violences lesbiennes (qui seraient la preuve qu’il n’y a pas de spécificité masculine dans le recours aux violences) pour dédouaner les hommes agresseurs et discréditer les travaux féministes ; tantôt ils reconduisent un imaginaire lesbophobe en associant de manière automatique identité butch (3) et lesbienne agresseuse, alors que des lesbiennes tant butch que fems peuvent être violentes et abusives dans leurs relations intimes.
Dans ce contexte, les études sociologiques sur les lesbiennes agresseuses deviennent un matériau prisé par les défenseurs de l’ordre patriarcal. Vanessa Watremez se souvient d’une de ses interventions au Québec en 2004. « Il y avait des masculinistes présents à l’entrée du colloque qui avaient repéré la thématique, raconte-t-elle. Évidemment qu’ils étaient trop contents qu’on parle de ça. » Vingt ans plus tard, en France, ce sont encore des personnes proches des milieux masculinistes qui ont tweeté avec le hashtag #MeTooLesbien pour discréditer la parole des victimes. Pour Lucie, cette tentative de nuire au mouvement n’est qu’une énième démonstration des violences masculines qui s’invitent dans un espace lesbien, « la seule sphère dans laquelle ils ne seront jamais les bienvenus ». Mais dans un contexte d’instrumentalisation des vécus lesbiens par des militantes transphobes ou nationalistes, ce sont d’autres personnes que la jeune femme avait peur de voir débarquer sur les réseaux sociaux : « Je craignais que ce #MeToo soit un jour créé par des terfs (4) ou des militantes d’extrême droite. »
Des acteurs institutionnels peu sensibilisés
Porter plainte, est-ce envisageable ? « À l’origine de nos mouvements, il y a des émeutes anti-flics en réaction aux descentes dans les lieux LGBT, rappelle Sophie en faisant référence aux émeutes de Stonewall (5). Ce passé, on le porte en nous quand on est un peu politisé·e, ce que je suis. Donc c’était très compliqué pour moi de pousser la porte d’un commissariat. » Elle le fera malgré tout, pour déposer une main courante, et le parquet se saisira de lui-même face à la gravité des faits.
Pour En avant toute(s), Nabintou Mendy a elle-même accompagné de nombreuses personnes LGBT+ dans leur dépôt de plainte auprès de la police. Elle a constaté à quel point les faits dénoncés sont minimisés lorsqu’ils sont perpétrés par des femmes. L’association redirige aujourd’hui les victimes vers des officiers qu’elle estime de confiance. « Les personnes non formées partent du principe que des violences conjugales, c’est forcément monsieur-madame », résume Nabintou Mendy. Et même les professionnel·les sensibilisé·es sur ces questions ne renoncent pas facilement à leurs premiers réflexes : « Statistiquement, les personnes violentes sont majoritairement des hommes. Donc on continue de partir de ce postulat-là. »
Au-delà de la police, les autres acteurs institutionnels, absorbés par le travail à accomplir dans la lutte contre les violences masculines, peinent à s’emparer de la question des violences en milieu queer. « Les structures d’accompagnement de victimes se rendent bien compte qu’il faut progresser sur les questions LGBT+. Certaines ont envie de se former, mais nous n’en sommes qu’au début », souligne Nabintou Mendy. Les structures LGBT+ ne sont pas spécialement sensibilisées à l’accompagnement de personnes victimes de violences conjugales, et inversement. Le matériel de prévention est, de fait, inadapté : par exemple, le violentomètre (un outil très largement diffusé qui permet d’autoévaluer sa relation de couple en situant sur une échelle différents actes violents) genre l’agresseur au masculin. « Il pourrait être plus inclusif, dégenré, souligne Nabintou Mendy, mais il existe des craintes dans le milieu que cela affaiblisse le message politique qui est derrière. » Comme si les personnes queer ne pouvaient pas s’emparer pour elles-mêmes des outils féministes de lutte contre les violences, alors qu’elles sont elles-mêmes investies dans les combats féministes.
Pourtant, pour appréhender ces sujets, des recherches sociologiques existent depuis quarante ans. Vanessa Watremez a travaillé dès le début des années 2000 sur des guides d’accompagnement de lesbiennes autrices et victimes de violences conjugales pour le GIVCL (le Groupe d’intervention en violence conjugale chez les lesbiennes), devenu depuis le Centre de solidarité lesbienne. Si, au Québec, elles ont permis dès le début des années 2000 d’améliorer la prise en charge des victimes LGBT+, en France, les initiatives sont plus timides : le Plan national pour l’égalité, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+, présenté par la Dilcrah (6) pour la période 2023–2026, mentionne une meilleure intégration des LGBT+ dans les campagnes sur les violences conjugales, mais il est encore trop tôt pour en mesurer les effets concrets.
La violence intime entre femmes, un enjeu féministe
Face au déficit de ressources, chaque initiative, même isolée, fait office d’oasis. « Je me rends compte de l’ampleur du vide qu’il y avait, je ne pensais pas qu’autant de personnes me contacteraient via mon compte Instagram », souffle Sophie. Ce compte, d’abord imaginé comme un espace de partage de témoignages, est devenu une association qui organise des groupes de parole entre victimes. La conscientisation et la formation des milieux militants sont un enjeu crucial. Pour les femmes hétéros victimes de violences, les milieux féministes non mixtes sont des lieux refuges. Pas pour les personnes queer. « Il y a un sentiment d’absurdité à être dans un espace féministe et y croiser la personne qui s’est comportée de manière pas du tout féministe », insiste Rizzo Boring. Pour ne pas prendre le risque de recroiser son agresseuse, elle a arrêté de se rendre aux événements festifs et militants de sa région : « Cela fait des années que je ne viens pas, et il ne se trouve personne pour assumer la responsabilité de mon absence ». C’est que la disparition silencieuse d’un·e de ses membres est plus facile à vivre pour un groupe que « d’affronter la personne qui a commis des violences ».
« C’est important de rappeler qu’être féministe ne nous protège pas des violences conjugales. »
Rizzo Boring, artiste et illustratrice
Prendre à bras le corps la question au sein des collectifs et des communautés, sans gêne ni pudeur, reste encore un acte trop rare, alors même que certaines agresseuses sont parfois capables de prendre conscience de leurs comportements violents. « En lisant les témoignages, une personne a reconnu ses propres agissements, elle s’en voulait et regrettait », témoigne Lucie de #MeTooLesbien. Vanessa Watremez se souvient elle aussi avoir rencontré des femmes conscientes de la gravité de leurs actes, et qui demandaient à être aidées. Le constat l’a d’abord surprise : « Il est très rare qu’un homme violent dise “Je suis violent, aidez-moi, je veux arrêter”. J’étais étonnée que cette démarche soit plus simple pour des lesbiennes. Mais cela s’explique par la socialisation des femmes. Il est moins toléré d’être violente, on se responsabilise plus là-dessus, et on se remet plus facilement en question. »
Cela montre que la violence intime entre femmes relève d’un enjeu féministe. Les victimes ont besoin aujourd’hui d’allié·es, pour penser des alternatives au silence et construire un accompagnement sur mesure, loin des automatismes hétéros inadaptés. Loin aussi de l’idée préconçue selon laquelle le milieu queer serait à l’avant-garde des modes de relation. « Si on veut vraiment devenir inspirant·es dans nos manières de relationner de manière intime les un·es avec les autres, conclut Sophie, il faut s’y atteler, maintenant. » •
(1) Le terme femme est utilisé dans cet article pour désigner toute personne s’identifiant dans le genre femme, qu’elle soit cisgenre ou appartenant aux minorités de genre (trans, non binaire, genderfluid…).
(2) Le gaslighting est un ensemble d’attitudes incluant le mensonge, l’omission ou la manipulation d’éléments factuels, qui visent à faire douter une personne de sa perception de la réalité.
(3) « Butch » désigne une femme lesbienne à expression de genre plutôt masculine, tandis que « fem » recoupe une expression de genre plutôt féminine. Au-delà de cet aspect descriptif, les termes définissent des formes d’identité au sein de la communauté lesbienne.
(4) Terf, acronyme de Trans-exclusionary radical feminist, désigne les femmes qui excluent les personnes trans des espaces féministes. Elles ont pour argument récurrent la mise en danger des femmes par la présence de femmes trans dans les espaces communautaires.
(5). En 1969, à la suite d’une descente de police dans un bar gay de New York, le Stonewall Inn, des émeutes éclatent. L’événement marque l’émergence du mouvement pour les droits des personnes LGBT+ aux États-Unis.
(6) Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT.